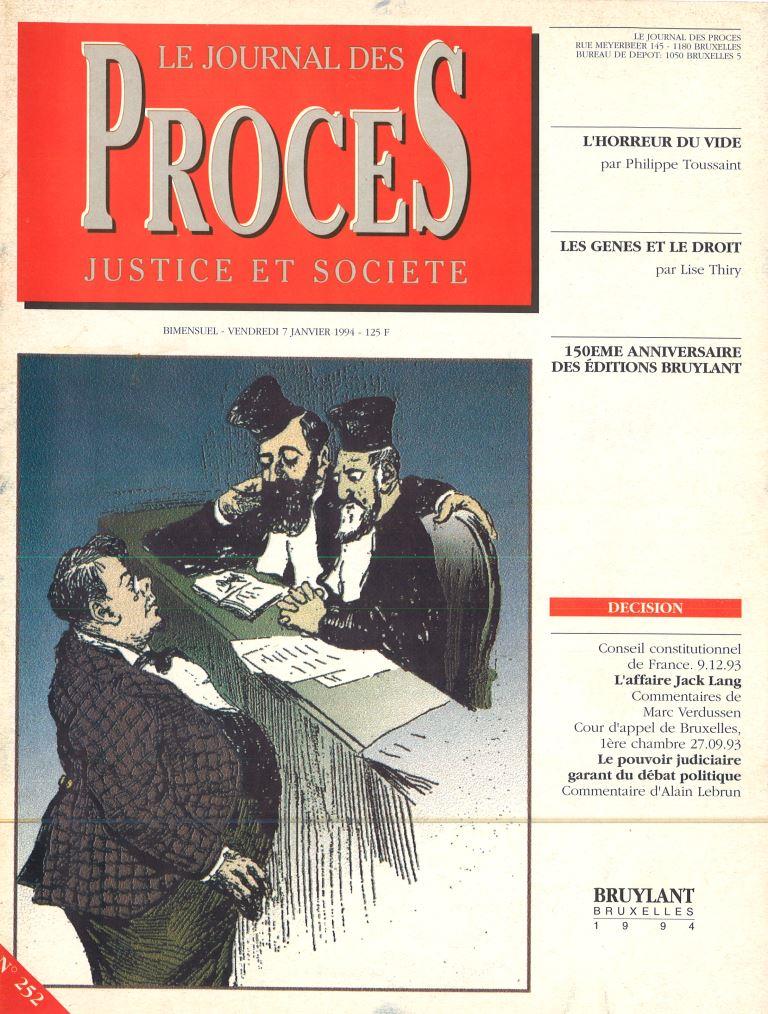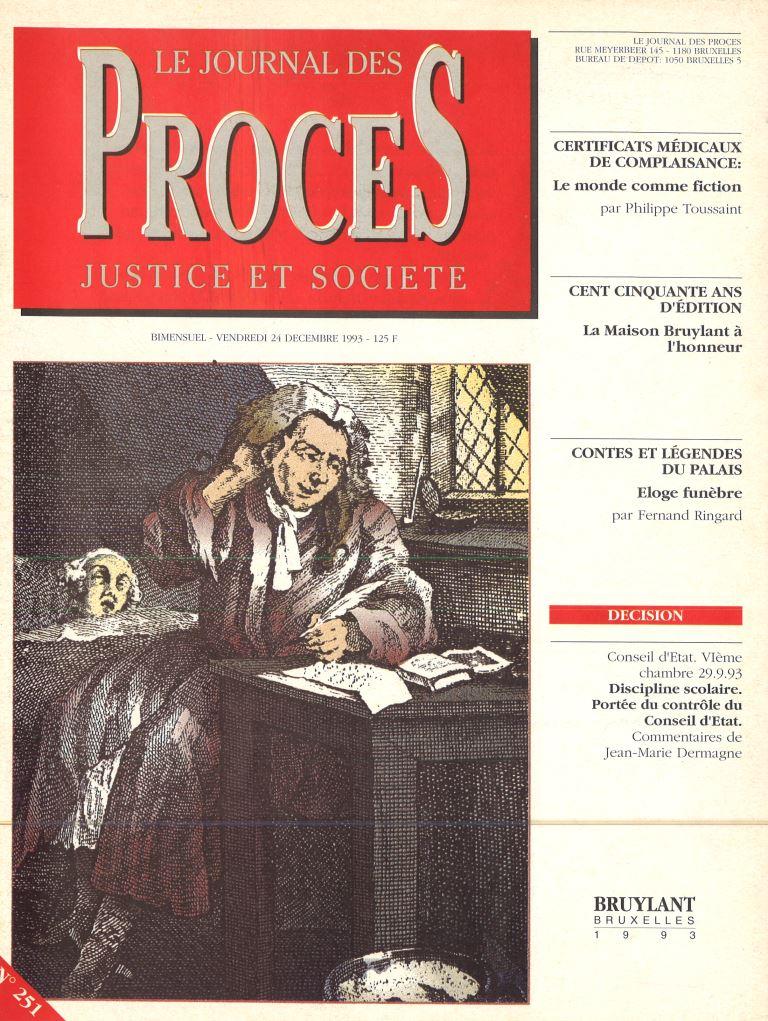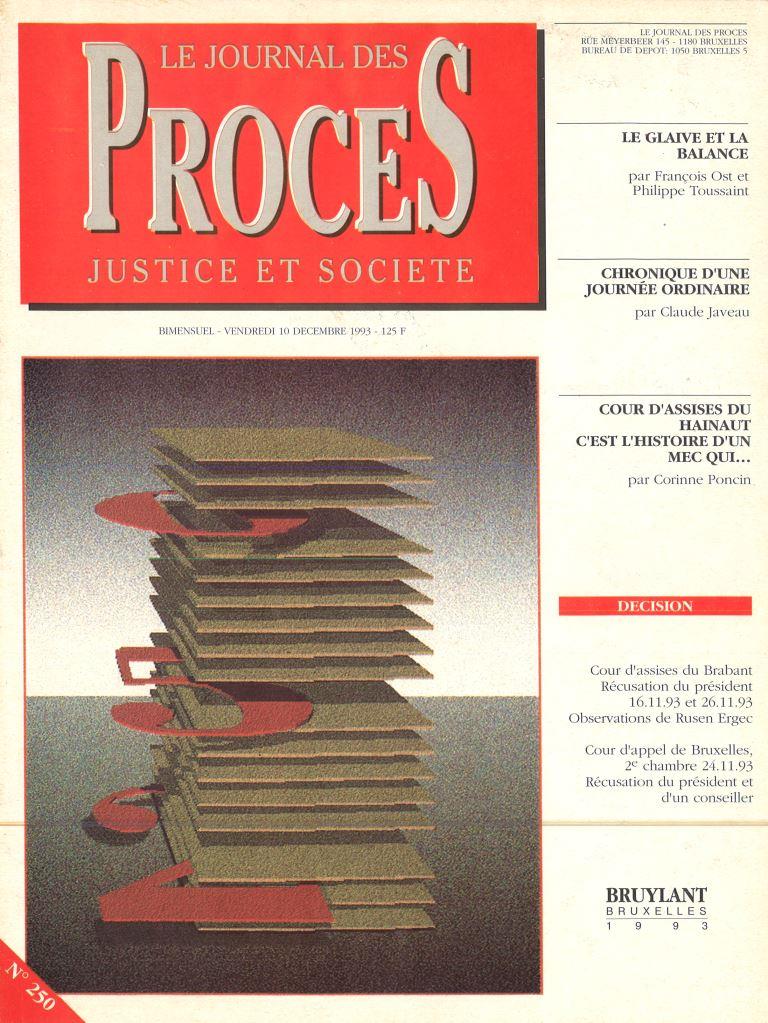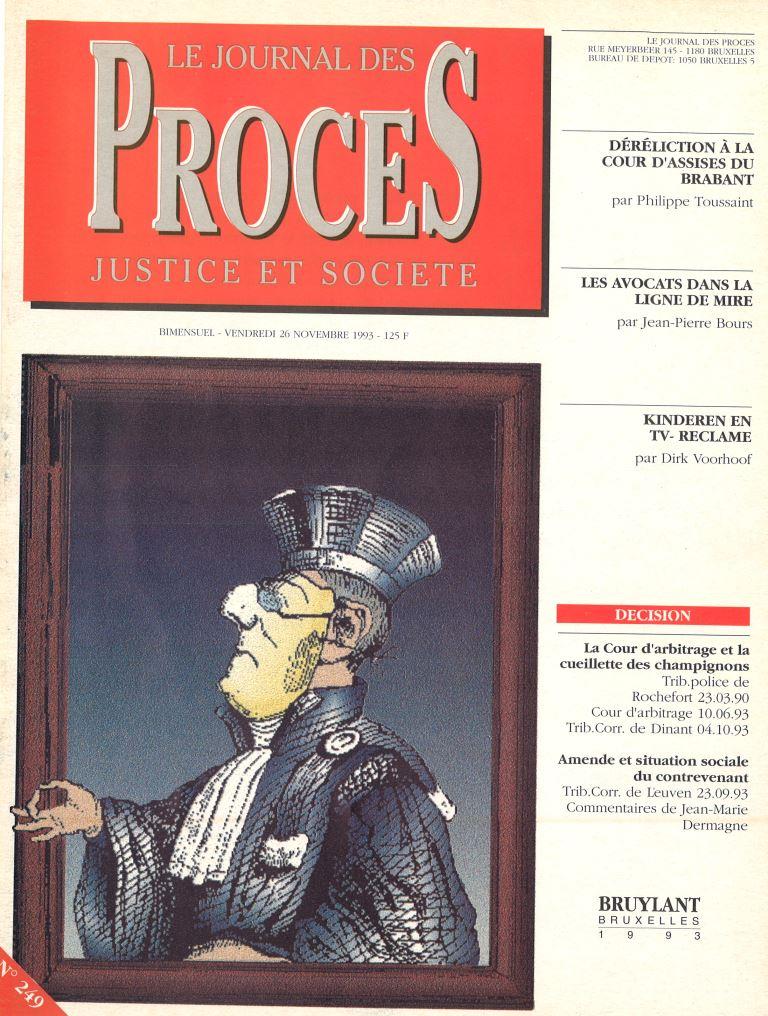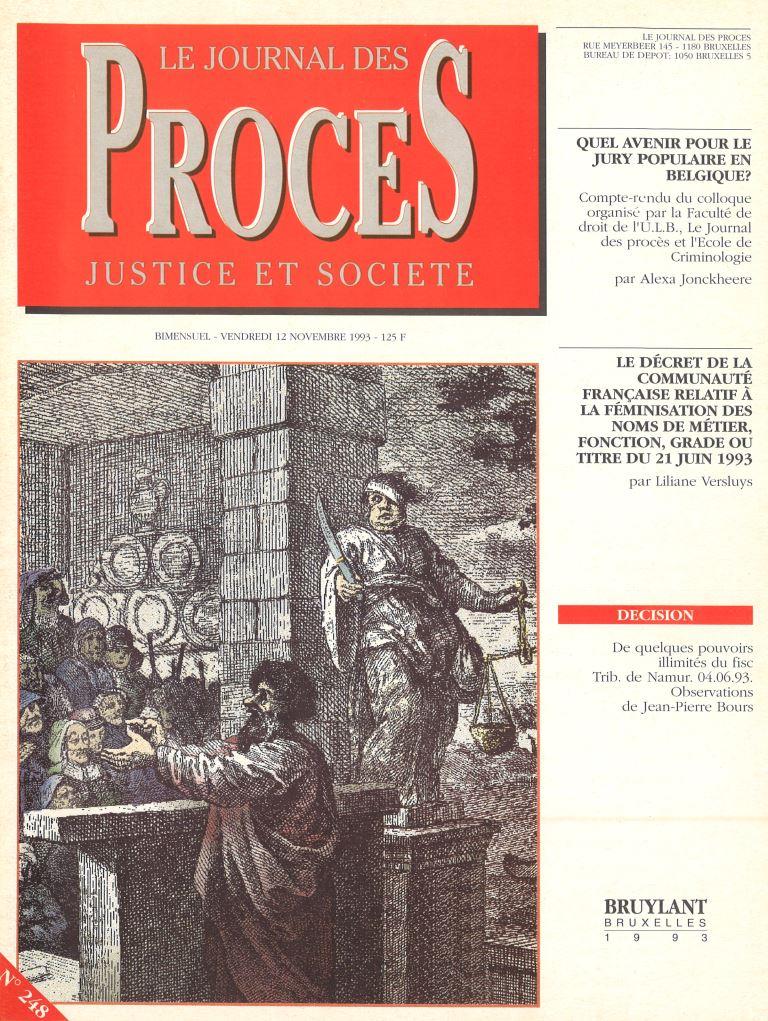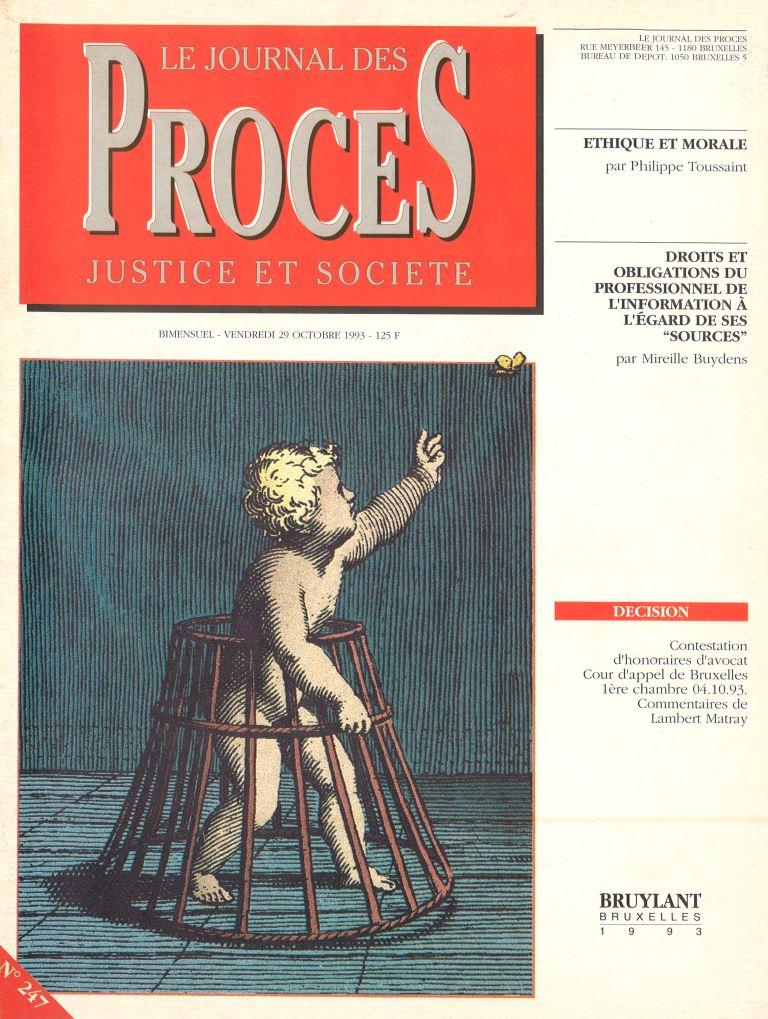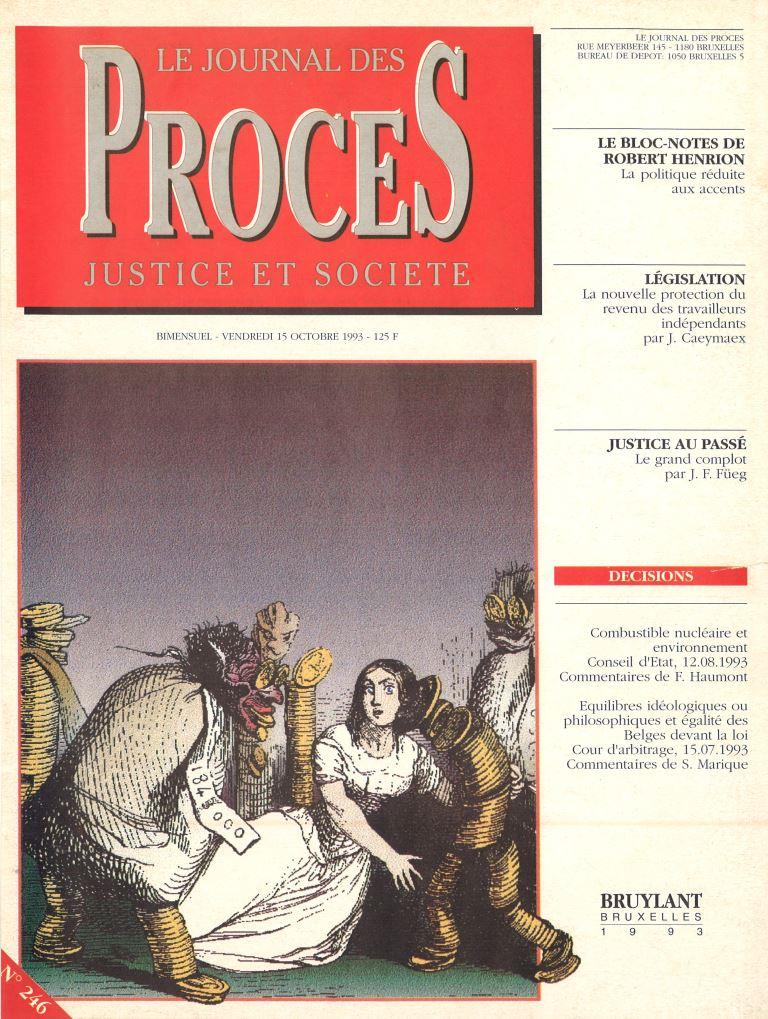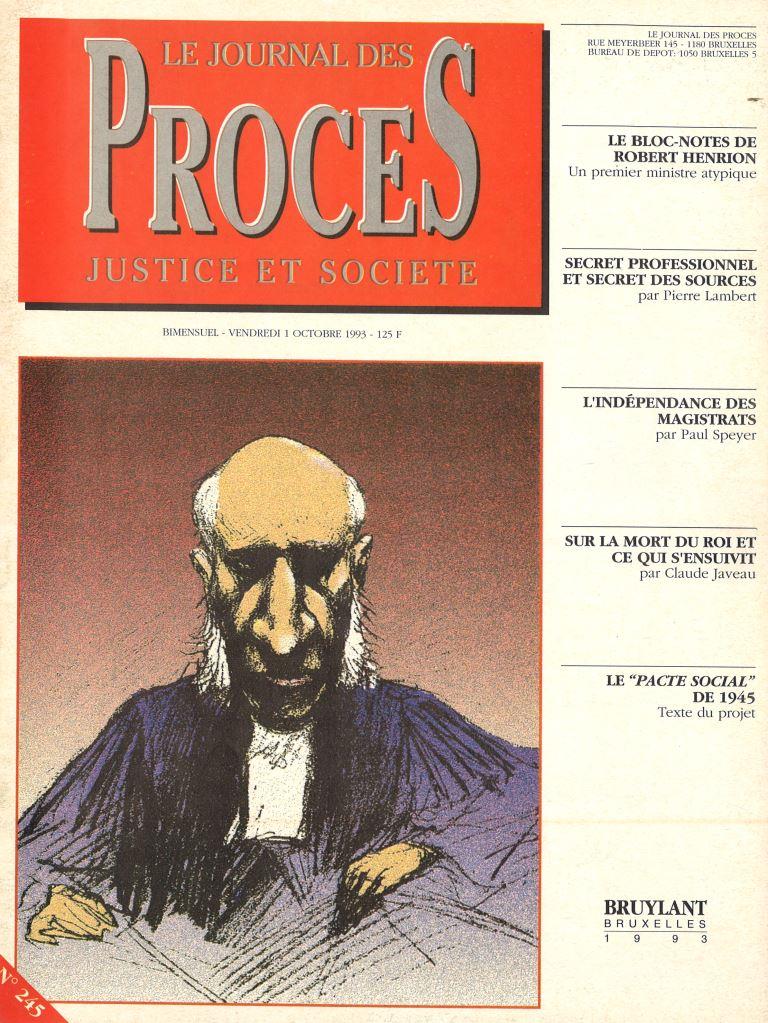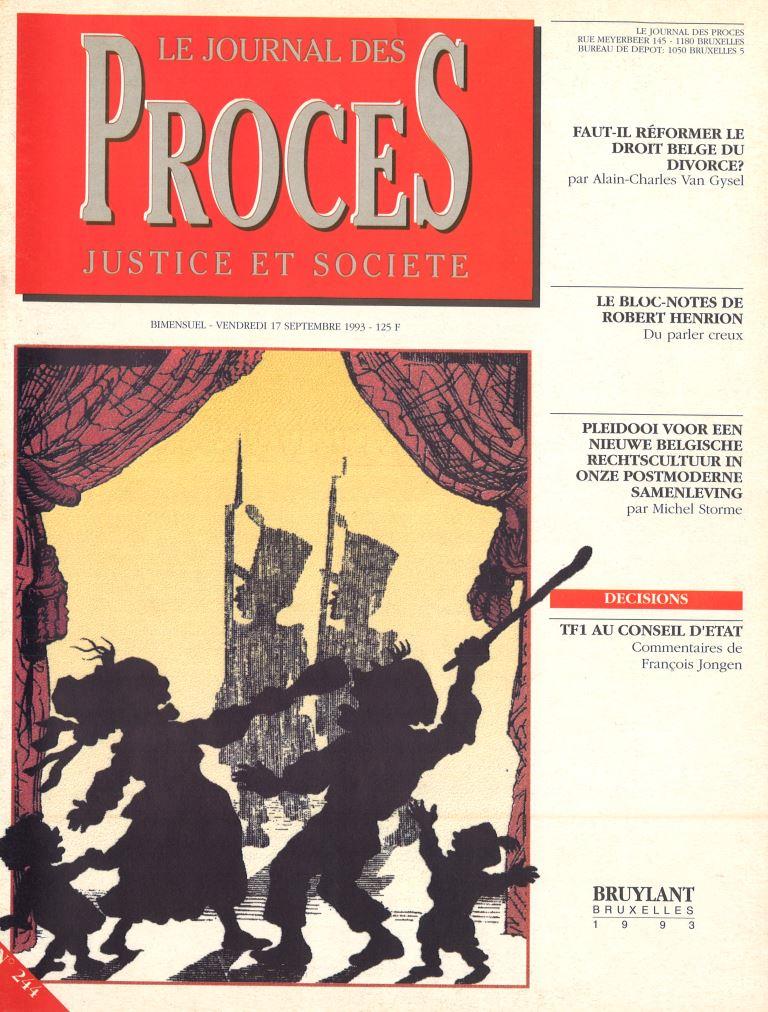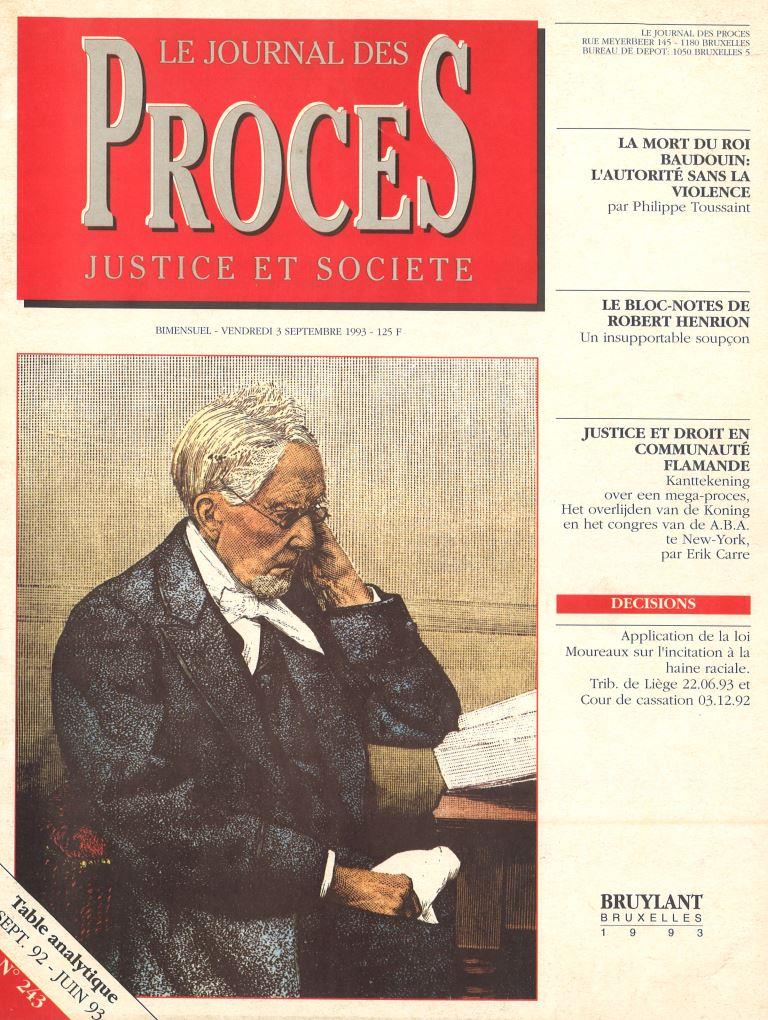Chères Lectrices, chers Lecteurs, Sire, Messieurs les cardinaux et les hauts ou bas magistrats, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les hospodars héréditaires , chers amis de tout poil, en ces beaux jours à peine un peu plus vieux de la nouvelle année, nous venons vous présenter, d’un cœur sincère et sans apprêts, en prose et non en vers faute de temps et d’un dictionnaire des rimes, nos meilleurs vœux. Sachez qu’ils ne sont point formels ni vains car ce sont ceux que l’optimisme nous dicte, persuadés que nous sommes qu’il est la meilleure méthode de gouvernement, à commencer de soi.
Les chances sont comme les topinambours ou les carottes, il suffit d’en planter ou semer congrûment les tubercules ou les graines pour qu’elles sortent de terre ! Tout est possible, sinon à portée de main, en 1994 à la seule condition de le vouloir et partant, de savoir ce que nous voulons. C’est ce qui ne dépend certes pas d’un programme mais ressortit plutôt à un état d’esprit. Les méchantes gens sont d’abord et toujours des pessimistes, comme Emmanuel Kant le démontrait admirablement : leur égoïsme ne saurait épanouir leur nombril que s’ils sont seuls à le cultiver. Érigée en loi universelle, leur volonté s’effondrerait.
Nos vœux, notez-le bien, sont précis. Ils participent en somme de la discipline, celle du sourire à chaque occasion, et notamment à destination des personnes du sexe opposé, de l’art, si malaisé parfois, de calmer le jeu quand le ton monte, du parti-pris d’être gentil plutôt que bon, car la modestie est expédiente, et de troquer enfin une fois pour toutes la superbe contre l’équanimité. Le génie ne peut rien contre le talent…
Tout est possible en 1994, vider les prisons et faire la paix en ex-Yougoslavie, guérir ses écrouelles et reprendre le dessus.
“C’est bien joli tout ça, mais…”grommellent les pessimistes. D’emblée, leur défaite est consommée car il tombe sous le sens que si c’est joli, c’est qu’on est dans le bon ! Il n’y a pas moyen, le voudrait-on, de se tromper quand on chante juste. Voyez les petits oiseaux dont notre ami Paul Foriers disait que les juges leur ressemblent – ou le devraient – quand ils rendent leurs jugements ! Bonne année, bonne santé morale !
Philippe Toussaint
Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…