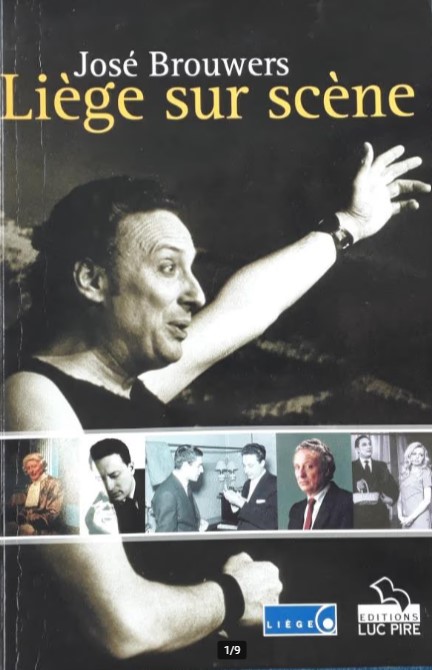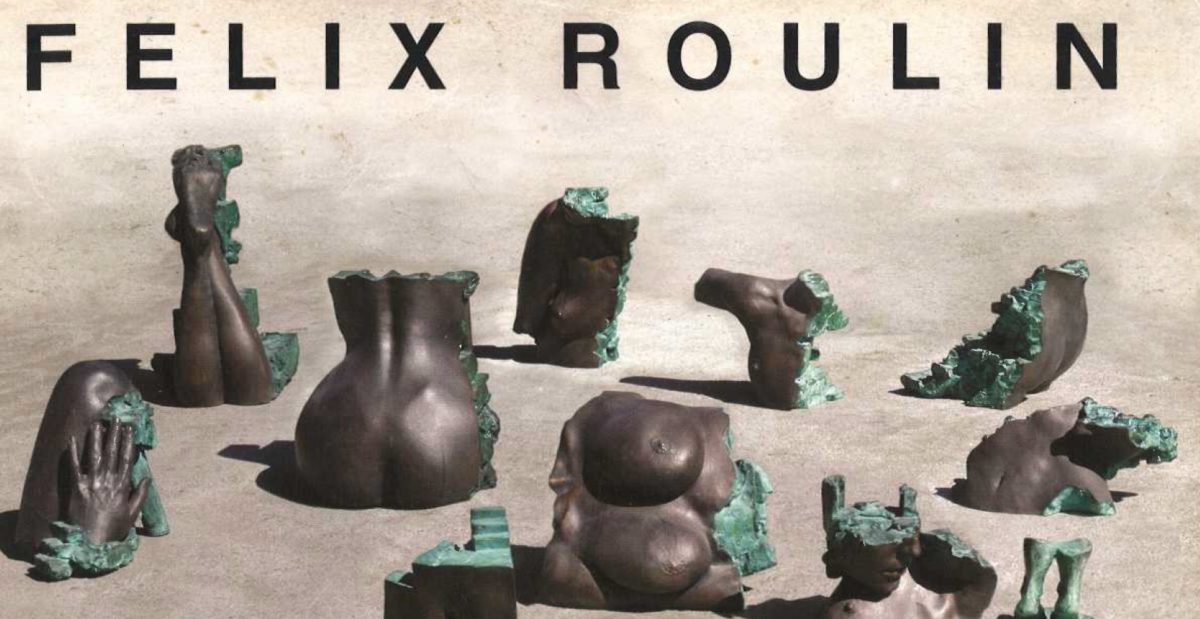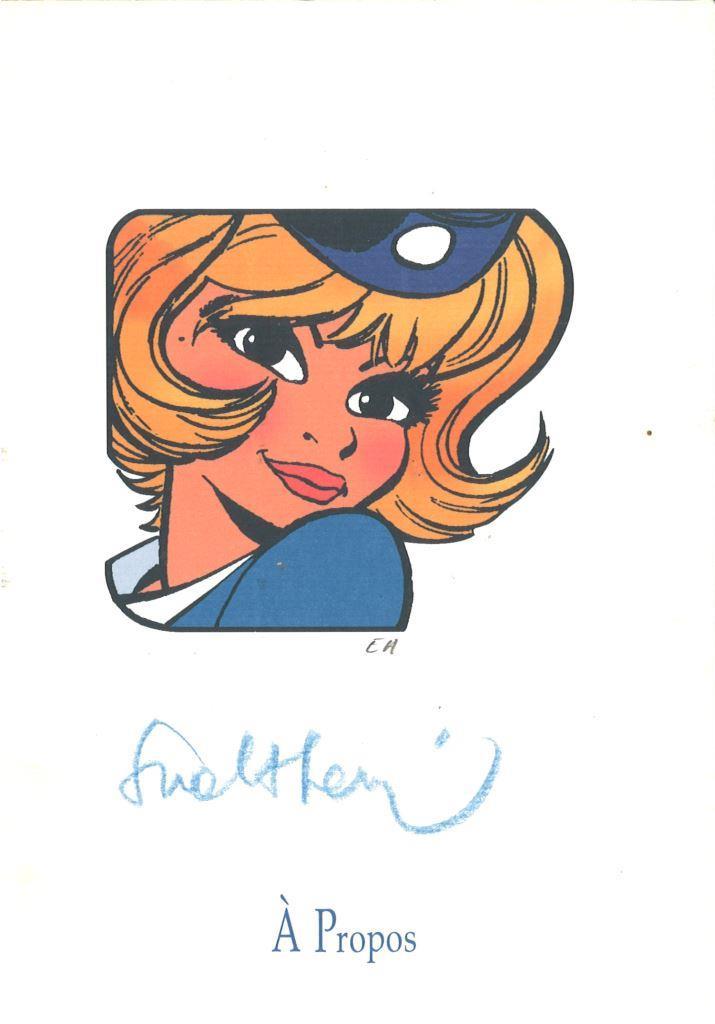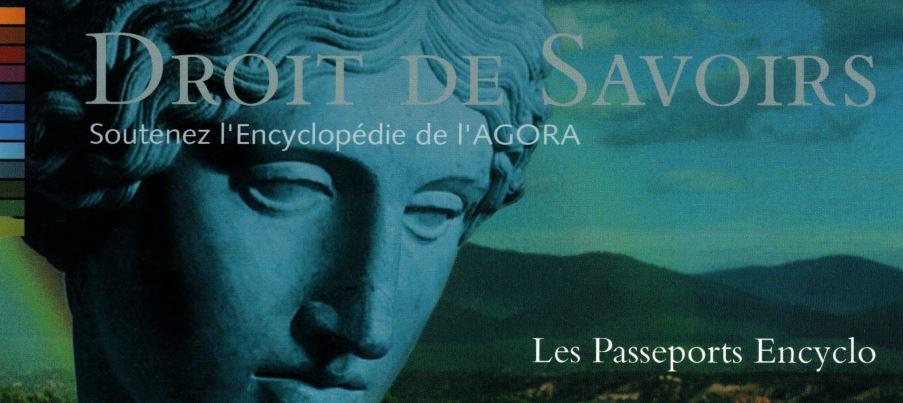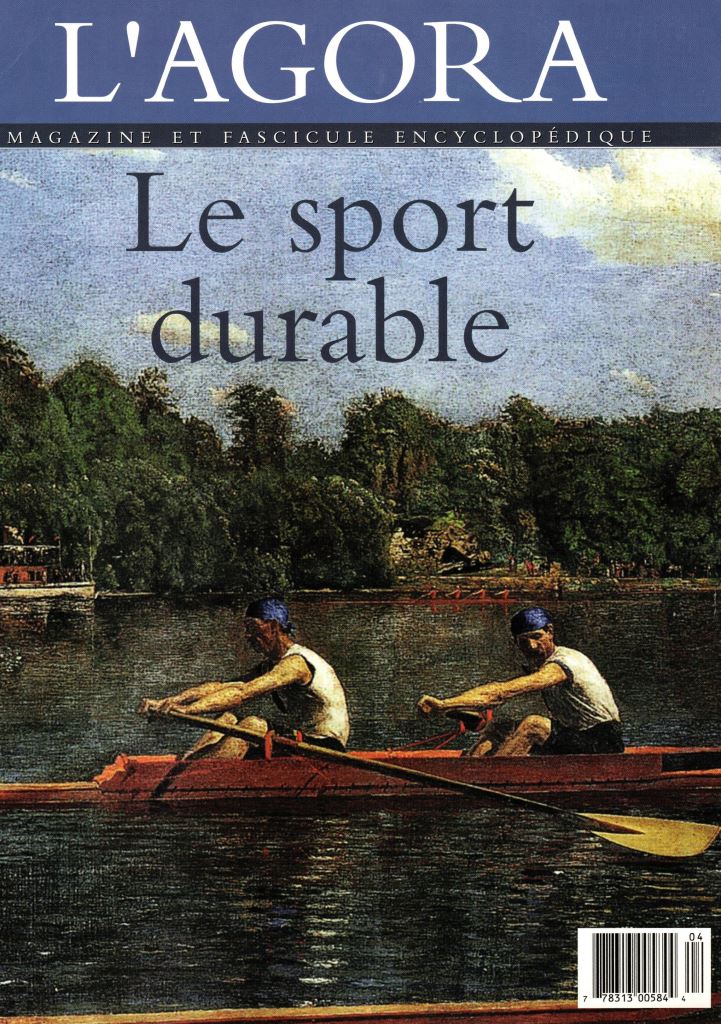Liège sur scène. Et pourquoi pas Liège sur Seine ? Ou Paris sur Meuse ? C’est que nous portons le cœur en bandoulière aux couleurs que chantait Chevalier et qui composent la fleur de Paris. Du Paris auquel Liège tente un peu de ressembler par son petit « Quatorze Juillet», sa frivolité, sa bohème, ses coquetteries et son négligé. Et puis par ses théâtres qui doivent plus à Paris qu’à Bruxelles. On y goûte davantage Molière ou Pagnol que Ghelderode ou Beulemans. Ces théâtres, je pense les avoir connus et crois continuer de les connaître, tous un peu tournés vers la France et sa culture, si ce n’est vers son folklore, ses modes ou ses manies. Cela va d’Ariane Mouchkine au Moulin Rouge, de Sartre aux chansonniers montmartrois.
Voilà presque cinquante ans que je vis le théâtre à Liège. J’avoue y avoir tout fait. J’ai été spectateur d’abord, puis critique, comédien, metteur en scène, il m’est même arrivé de faire une régie ou d’aider à planter un décor. J’essaie de continuer à pratiquer ce métier unique et que des milliers de gens rêvent d’exercer. Professeur d’art dramatique pendant vingt ans, j’en ai vu défiler des élèves de tous âges, irrésistiblement attirés par notre miroir aux alouettes ! J’ai aimé tous ces aspects du métier du spectacle.
Je crois que c’est comme spectateur que j’ai connu mes plus grandes joies. D’ailleurs, un comédien est d’abord un spectateur. Trop d’acteurs ont tort de n’aller jamais au théâtre. On y perd rarement son temps même si les dieux, certains soirs, ne descendent pas sur le plateau. Tout ce qu’on y peut observer ! Ne serait-ce que les spectateurs : notre public d’hier ou de demain. J’avoue penser comme Alfred de Musset : « Il faut dans ce bas monde aimer beaucoup de choses pour savoir après tout ce qu’on aime le mieux ». J’ai donc appris à tout goûter : l’opéra et le théâtre un peu fou que nous vivons depuis les années cinquante dont celui d’Arrabal (lequel a fini par mettre en scène un opéra à Liège), la haute comédie aussi bien que la revue, le drame, même quand « on distancie », selon la formule de Brecht, et la farce dialectale.
Tout cela m’a familiarisé avec le Royal, le Gymnase (l’ancien et le nou-veau), le Trocadéro et l’Étuve, la Courte Échelle et le Trianon, la Place et le Moderne, le Proscénium et vingt autres endroits où les déesses du théâtre ont posé cothurnes ou pieds légers. On leur a quelquefois écrasé les orteils ou pincé les fesses à Thalie et à Melpomène, mais elles ne se sont pas offensées de ces familiarités, pas plus que Molière ne s’est gendarmé quand on a détourné Harpagon de sa cassette ou Tartuffe de sa discipline. J’ai écrit un livret d’opéra-comique et cela m’a donné la joie d’approcher dans leur vie quotidienne des musiciens et des chanteurs ; deux de mes comédies ont été adaptées en wallon, et j’ai pu admirer le tour de force hebdomadaire de ces acteurs qui maintiennent vivant notre dialecte. J’ai aimé travailler avec des femmes et des hommes de radio et de télévision, j’ai profité des gaîtés du music-hall (comme on disait avant que ne règnent les variétés) et surtout, j’ai adoré approcher Beckett avec Olinger, le directeur du Théâtre des Capucins, de Luxembourg, ou retrouver Molière à Bruxelles dans une production de Laurent Gaspard.
Vous comprendrez que j’ai des choses à raconter. La vie est pleine d’incidents qui deviennent des anecdotes quand ils cessent d’être dramatiques. Qui ne prend plaisir à les relater, ces entremets de la vie, en y mettant un brin de mensonge, juste ce qu’il faut pour rejoindre la vérité ?
José Brouwers
BROUWERS J., Liège sur scène est paru chez Luc Pire / RTBF Liège en 2000. L’ouvrage est aujourd’hui épuisé et n’a pas été réédité.
Table des matières
-
-
- Prologue
- Acte I : Beaucoup de bruit pour rien
- Acte II : Il ne faut jurer de rien
- Acte III: Comme avant, mieux qu’avant
- Acte IV : La main passe
- Acte V : Faisons un rêve
- Épilogue
-
[SUDPRESSE/LIEGE, 26 septembre 2000] Pour ses 50 ans de scène, José Brouwers a choisi de marquer le coup en couchant sur papier tous ses souvenirs : du Conservatoire à La Meuse où il a été journaliste, jusqu’à son immense carrière au Gymnase, sans oublier l’Arlequin, ce théâtre qu’il a créé et qu’il dirige encore aujourd’hui. Liège sur Scène, c’est certes le parcours d’un homme, mais c’est surtout un tableau de la vie culturelle liégeoise de ces 50 dernières années. La sortie officielle de l’ouvrage, aux éditions Luc Pire, est prévue pour ce 29 septembre, à l’Arlequin. En avant-première, nous vous dévoilons quelques extraits d’un livre plein d’anecdotes…