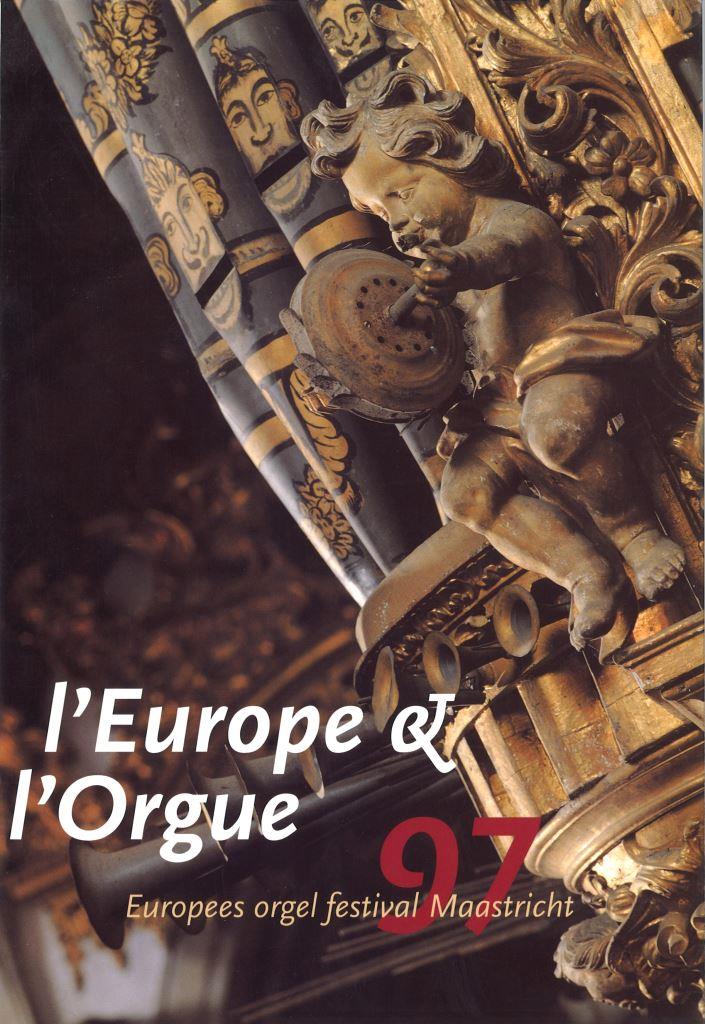“Il aura fallu plus de cinq ans à nos Gouvernements pour arrêter officiellement, à la fin du mois de janvier [1990], l’itinéraire du TGV-Nord dans notre pays. La décision est sans surprise ; elle se dissimulait déjà entre les lignes de l’accord du 10 mai 1988 ; de nombreux signes l’annonçaient de plus loin encore. Pendant cinq ans, l’IRI [Innovation et Reconversion Industrielle, asbl] s’est employée sans relâche à faire triompher la solution digne de l’Europe et conforme aux intérêts nationaux. Le plan gouvernemental en est parfois loin quoique des points essentiels soient acquis. La situation qui en résulte, vaut d’être examinée d’autant plus qu’un dossier, même clôturé, n’est jamais achevé.
Ces pages ne sont pas un manifeste, encore que l’IRI qui a lutté au nom des forces économiques liégeoises pour que le TGV passe par Liège et s’arrête à la gare des Guillemins, puisse se réjouir d’avoir, sur ce point, obtenu gain de
cause.
Ce n’est pas, non plus, une contribution – qu’il eût fallu détailler considérablement – à l’histoire du dossier, bien que des faits singuliers, l’éclairant d’un jour très caractéristique, aient été relevés au hasard des circonstances.
Ce n’est pas, enfin, une radioscopie de l’exercice du pouvoir dans notre Etat
fédéral quoiqu’on ne puisse ignorer combien la décision finale du Gouvernement durcit les horizons régionaux et accuse son impuissance à les dépasser, à dégager les besoins d’une grande idée et à y répondre.
Non, ces quelques pages n’ont rien de polémique ni d’aussi ambitieux. Elles sont une réflexion sur un fait important de notre temps et un ultime appel au bon sens pour le mieux comprendre.”
Pierre Clerdent, Président de l’I.R.I.

Pour tout savoir :
[d’après CONNAITRELAWALLONIE.WALLONIE.BE] Pierre CLERDENT 5Liège 29/04/1909, Chaudfontaine 11/06/2006). Docteur en Droit de l’Université de Liège (1934), collaborateur de Paul Tschoffen et avocat près de la Cour d’Appel de Liège (1934-1945), il devient le secrétaire particulier du ministre Antoine Delfosse (1939). Délégué du ministre à l’INR et directeur du Comité permanent de la radio belge (1940), réfugié en France, il rentre au pays (été 1940) et fonde l’Armée de Libération dont il devient le chef national.

Colonel de Résistance, président de l’Union nationale et du Conseil national de la Résistance, résistant de premier plan, Pierre Clerdent alias « Max » est désigné en 1943 par le gouvernement belge à Londres, comme administrateur de la Radiodiffusion nationale belge en territoire occupé. Le 4 septembre 1944, il lui revient l’honneur d’inaugurer les ondes libérées.
Présent au Congrès national wallon d’octobre 1945, P. Clerdent est sensible aux problèmes économiques de la Wallonie, participe à l’expérience politique de l’UDB et contribue à la naissance et au développement du Conseil économique luxembourgeois au moment où il est nommé gouverneur du Luxembourg (1946-1953), avant de devenir le gouverneur de la province de Liège (1953-1971). Durant plus de 25 ans, il anime le Comité européen pour l’aménagement de la Meuse et des liaisons Meuse-Rhin. Il contribue à la fondation de la SPI (Société provinciale d’Industrialisation) et prend la responsabilité d’organiser une consultation populaire auprès des habitants des six communes de Fourons (28 octobre 1962).
En 1971, Pierre Clerdent démissionne de son poste de gouverneur pour des raisons de santé. Après plusieurs mois de convalescence, il devient le président du conseil d’administration de la SA Cockerill (1971-1981) et celui de l’Union minière et industrielle (1973-1990). Alors que viennent d’être votées les lois d’août 1980, Pierre Clerdent se présente à 72 ans sur les listes du PRL au Sénat, où il est directement élu (1981-1987). Il siège également au Conseil régional wallon où son parti est l’une des composantes de la majorité (1981-1987). En décembre 1981 comme en novembre 1985, Pierre Clerdent préside l’assemblée wallonne en tant que doyen d’âge.
Sénateur coopté (1988-1991), il ne siège plus dans les assemblées fédérées. Parmi les nombreux dossiers dont il eut à s’occuper ressort sa volonté de désenclaver la Wallonie et de l’inscrire dans les grands réseaux de communication européens. Sa défense passionnée en faveur du passage et de l’arrêt du TGV à Liège en témoigne.
Paul Delforge, Institut Jules Destrée