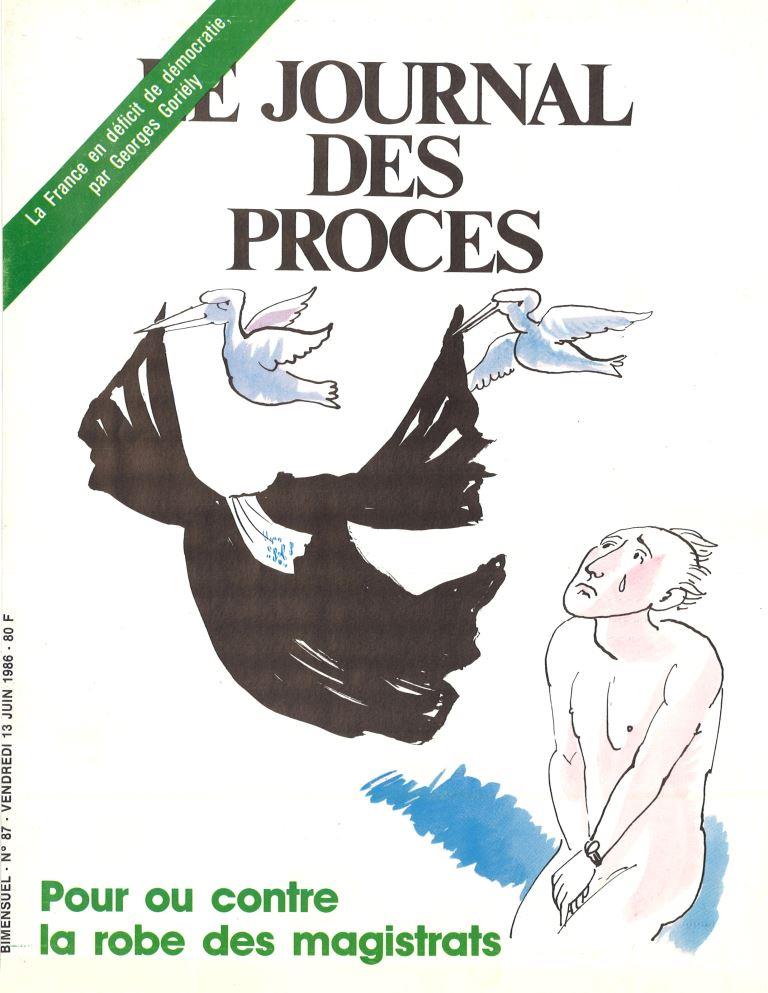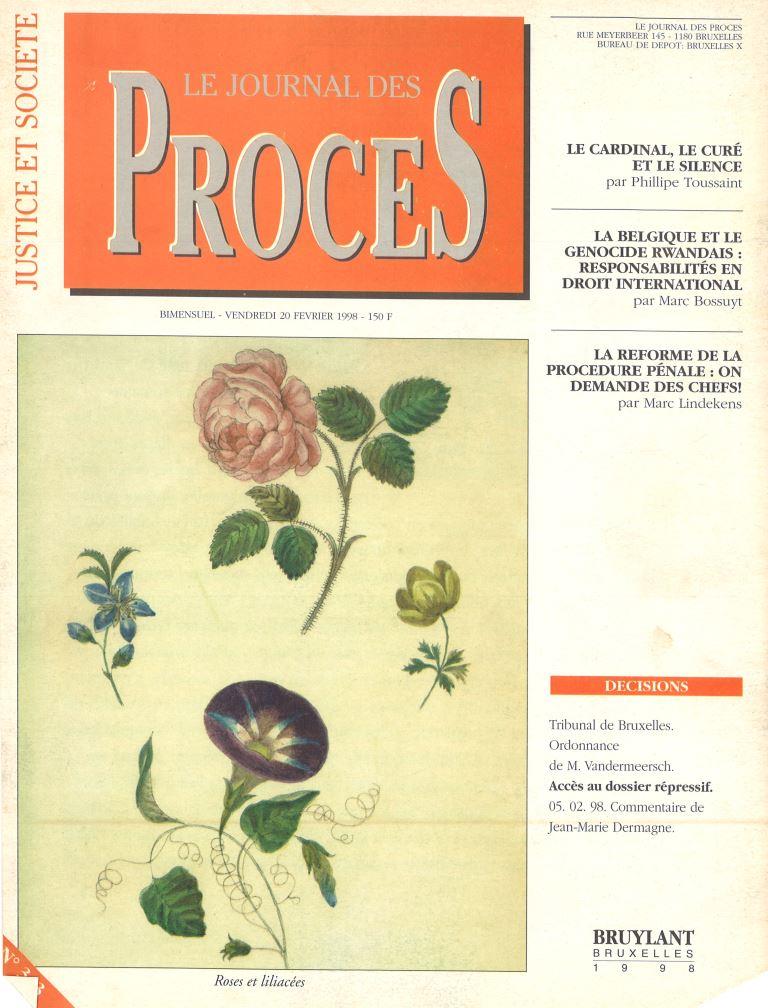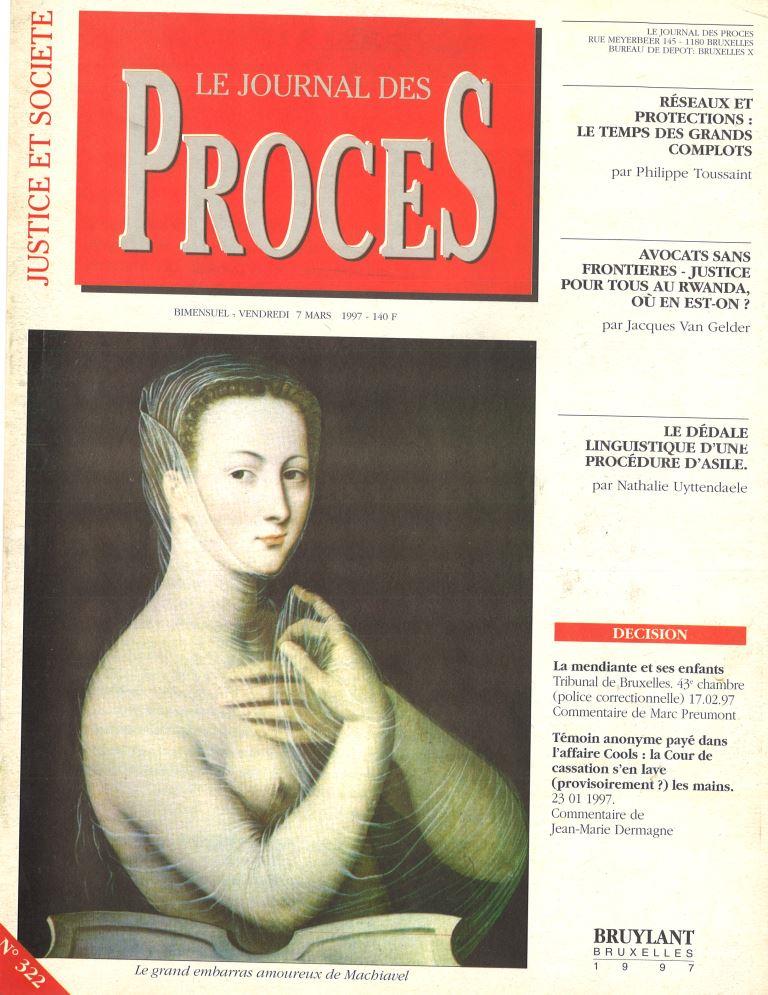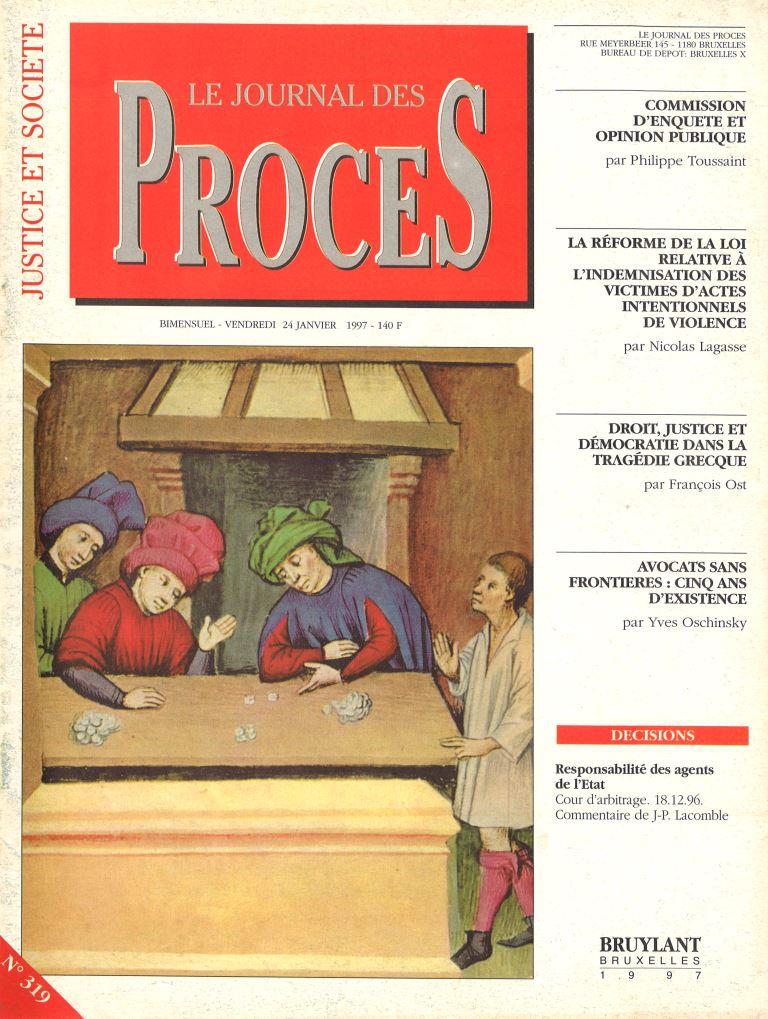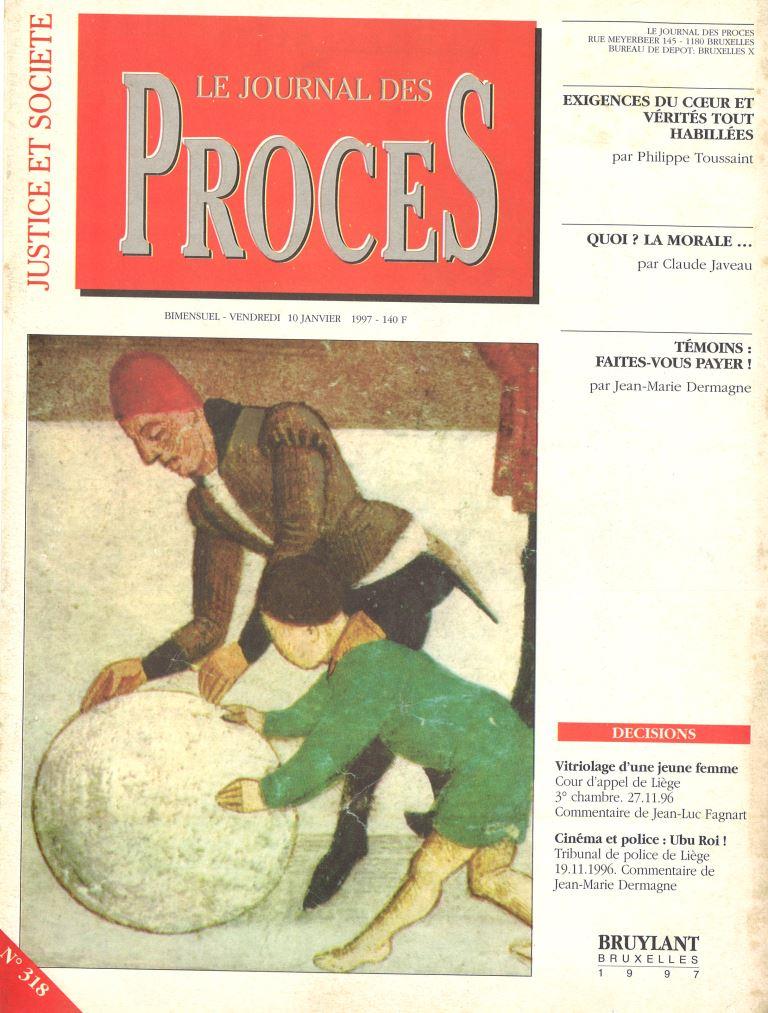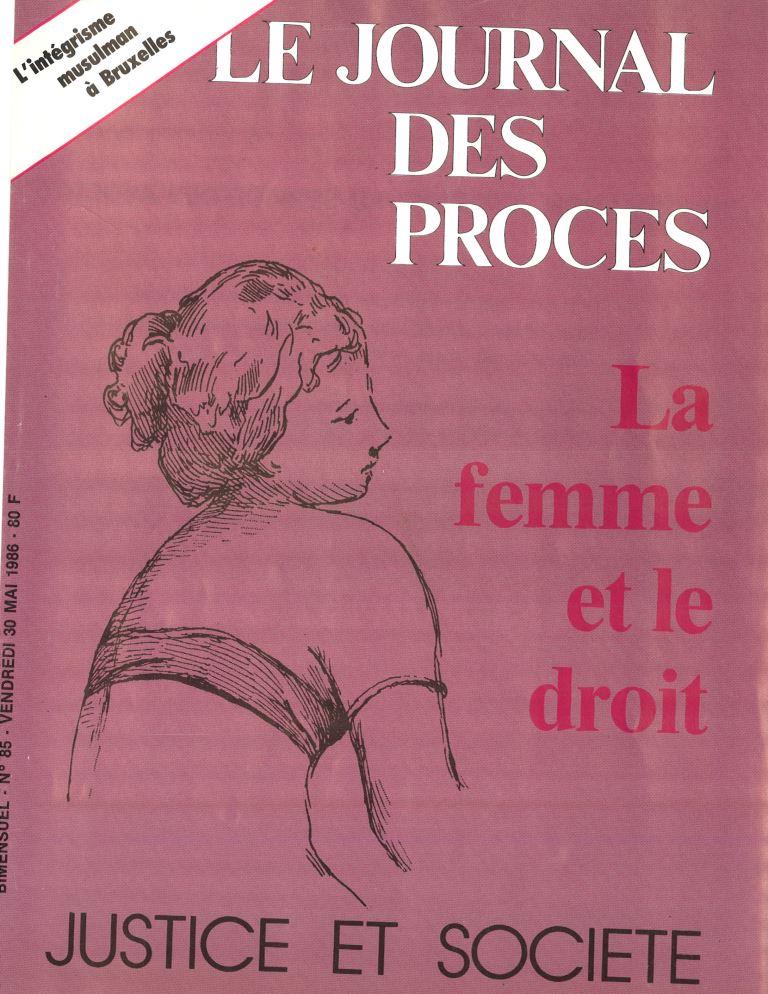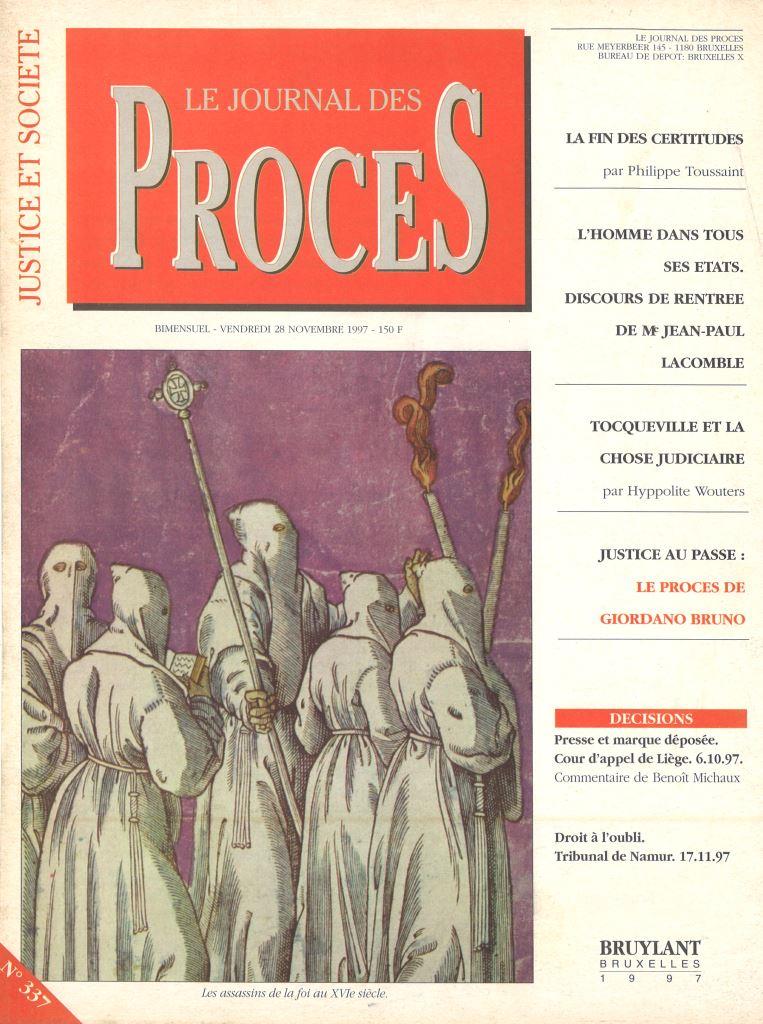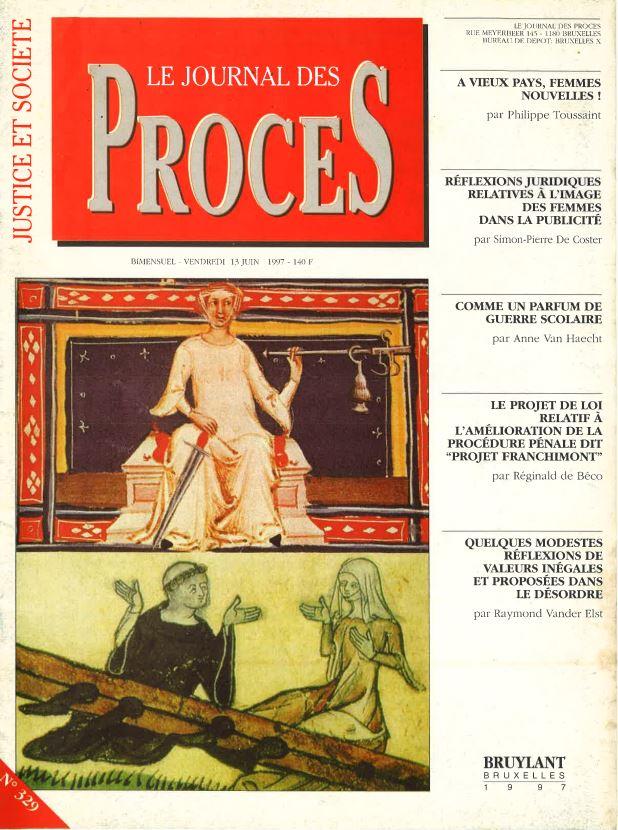L’idée – ou utilisons le mot plus vague de : sentiment, selon quoi la morale et toutes ces sortes de choses, dont d’aucuns aiment à dire: “C’est bien joli, tout ça, mais…” empêcheraient la réussite et que, dès lors, il suffirait d’agir décidément la truffe à ras de terre pour que les biens de ce monde soient à nous, cette idée, ce sentiment existent chez beaucoup. On serait pauvre parce qu’on est honnête ; ne soyons plus honnête et automatiquement, on devient riche !
On a un peu I’impression que c’est ce qui s’est passé avec l’élection du Président de la République autrichienne. C’est en s’encombrant de scrupules qu’on ferait une politique pleine de noblesse mais appauvrissant le pays. L’heure est aux réalistes et, en I’espèce, la réalité est qu’une majorité d’Autrichiens assument parfaitement un passé nazi, répugnant à une démocratie inefficiente et optant plutôt pour un Etat musclé.
C’est leur affaire. C’est la nôtre que M. Waldheim, dont il est en tout cas certain qu’il n’a pas dit toute la vérité sur sa conduite pendant la guerre, ait été Secrétaire général des Nations-Unies, lesquelles furent créées au lendemain de la guerre 40-45 pour que plus jamais le nazisme ne renaisse. Ce qu’on sait aujourd’hui de M. Waldheim, d’aucuns le savaient quand il exerçait ses hautes fonctions à New York. Les archives étaient là, et furent consultées – mais on ne nous dit pas par qui. Pour ceux qui ne disent pas de la morale et de ces sortes de choses que “c’est bien joli tout ça, mais…” c’est le coup le plus dur peut-être porté à ce grand espoir qui naquit au lendemain de la guerre.
Philippe Toussaint
Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…