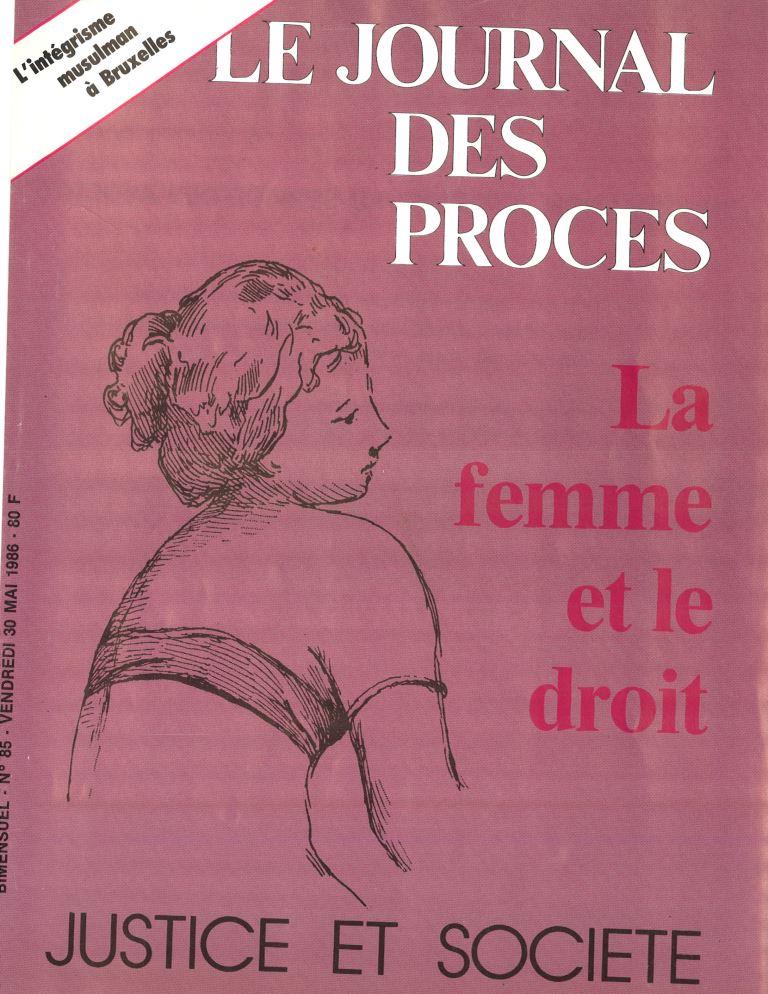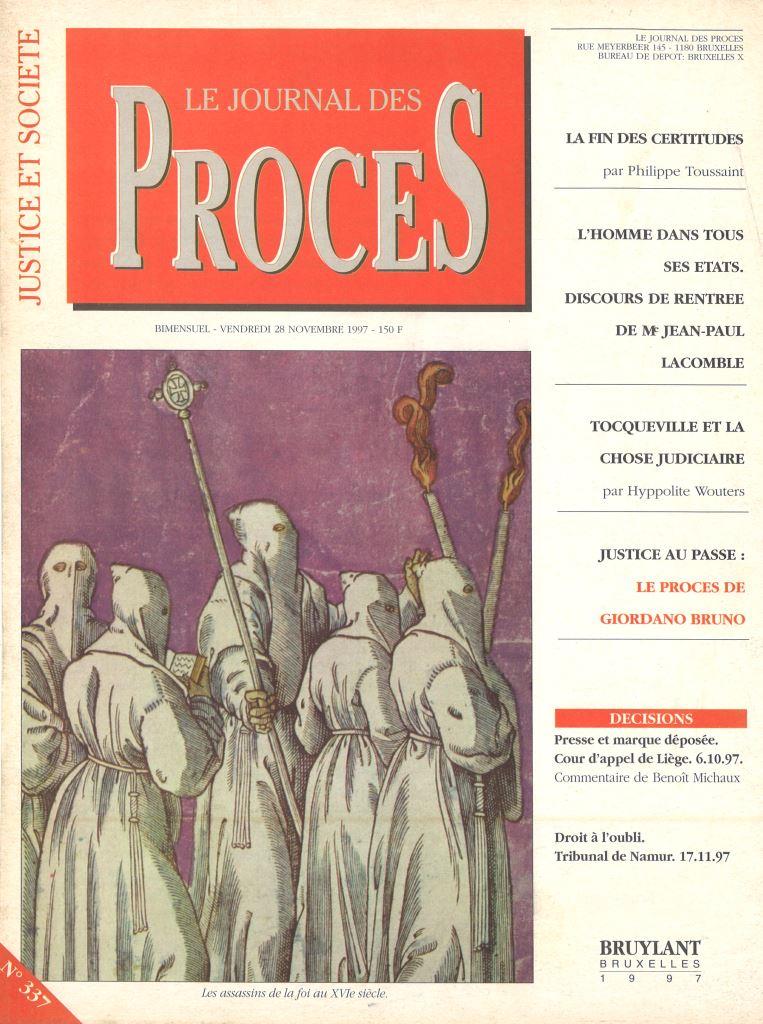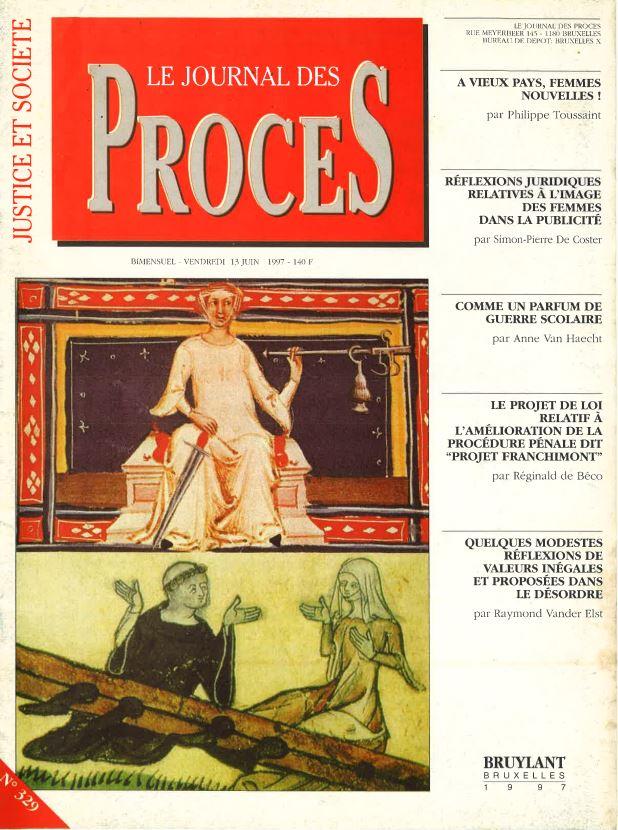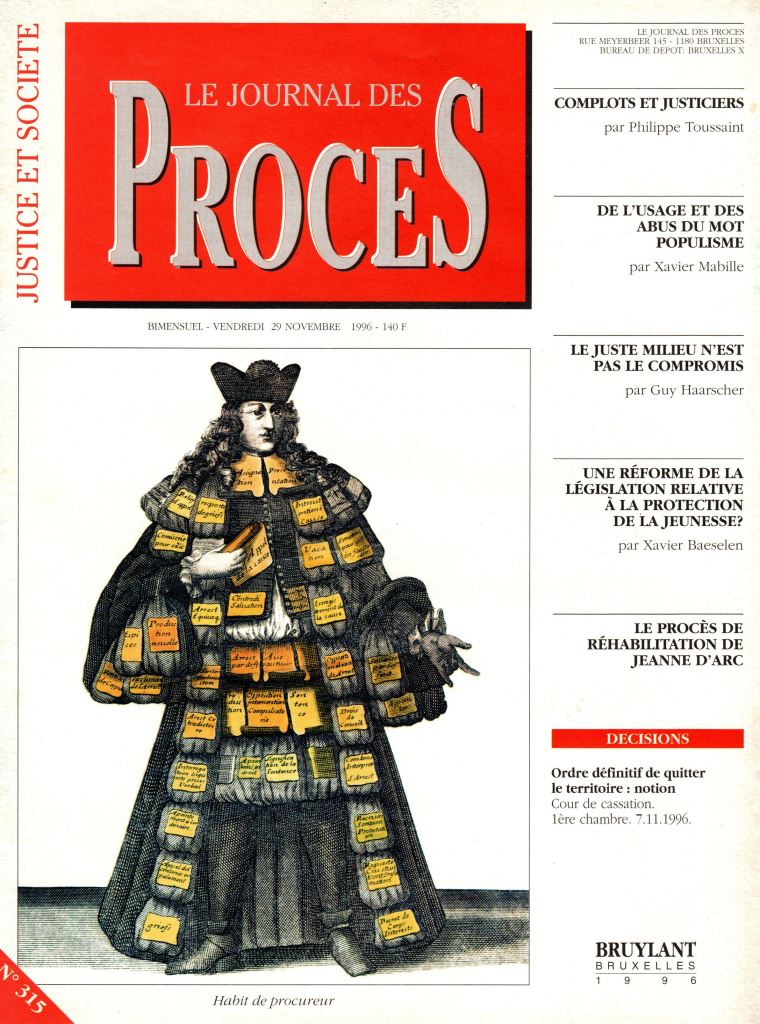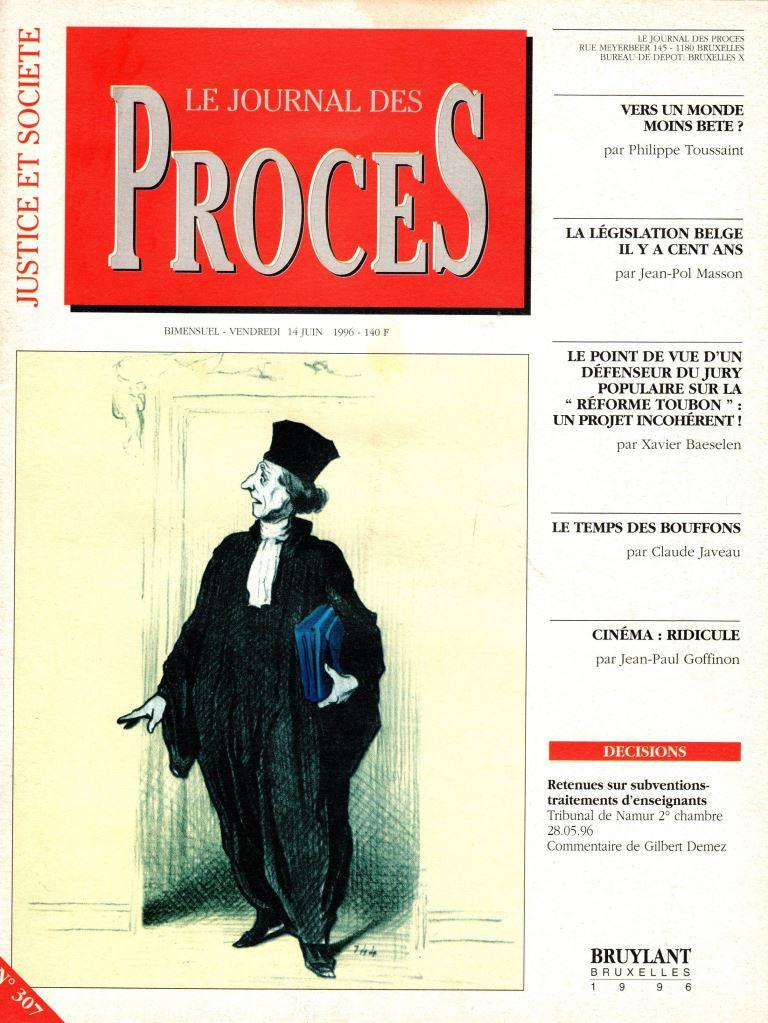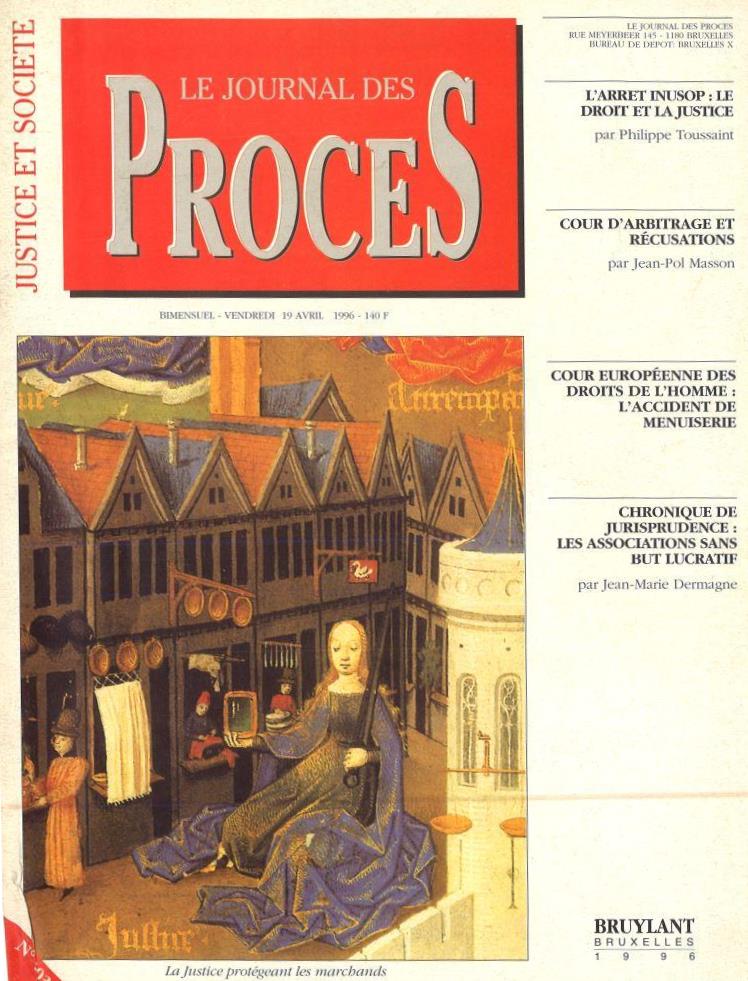L’arrêt rendu mardi après-midi à Bruxelles par la cour militaire, confirmant le jugement de première instance qui condamnait Olivier Dupuis à deux ans d’emprisonnement, mais en assortissant cette condamnation d’un sursis probatoire pour la moitié de la peine à la condition que l’intéressé travaille pendant deux ans au profit d’une association luttant contre la faim dans le monde, est un chef-d’œuvre dans son genre.
Confessons que nous n’avons jamais compris ce que cherchait au juste Olivier Dupuis, dont nul ne nie par ailleurs la sincérité et la générosité, en refusant tout à la fois de faire un service militaire et un service civil. La guerre, semble-t-il dire, si elle doit éclater, procédera des relations Nord-Sud, c’est-à-dire entre pays où on ne meurt pas de faim et ceux où c’est le sort d’un nombre immense. Donc, estime Olivier Dupuis, la meilleure manière de lutter contre un ennemi éventuel est de faire pression pour que les pays riches aident les pays pauvres. C’est oublier peut-être une autre problématique : le drame Nord-sud n’élude pas la tragédie Est-Ouest.
Reste que la cour militaire va au-delà des réquisitions du ministère public. Mais ce sont surtout les motifs de la décision (que nous ne manquerons pas de publier et de commenter) qui suscitent notre admiration en quelque sorte perverse. A tous les arguments de la défense tendant à récuser des juges militaires en ce que, dans une affaire pareille, ils sont à la fois juges et parties, la cour militaire trouve des réponses qui ressortissent curieusement à une tautologie. Comment des juges militaires pourraient-ils se laisser influencer, sous-entendu par les idées-mêmes qui sont à la base de leur engagement idéologique ? Leur honneur de soldat est un garant suffisant. Ils sont indépendants, comme d’ailleurs, précise I’arrêt, les juges civils, qui n’ont pas d’étiquette politique.
Tout cela a été lu imperturbablement par M. le conseiller Durant, dans un silence d’autant plus impressionnant qu’on avait I’impression qu’il aurait suffi d’un enfant, faisant une remarque naïve, pour qu’on se réveille.
Philippe Toussaint
Cliquez ici pour retourner à la page-mère du Journal des procès…