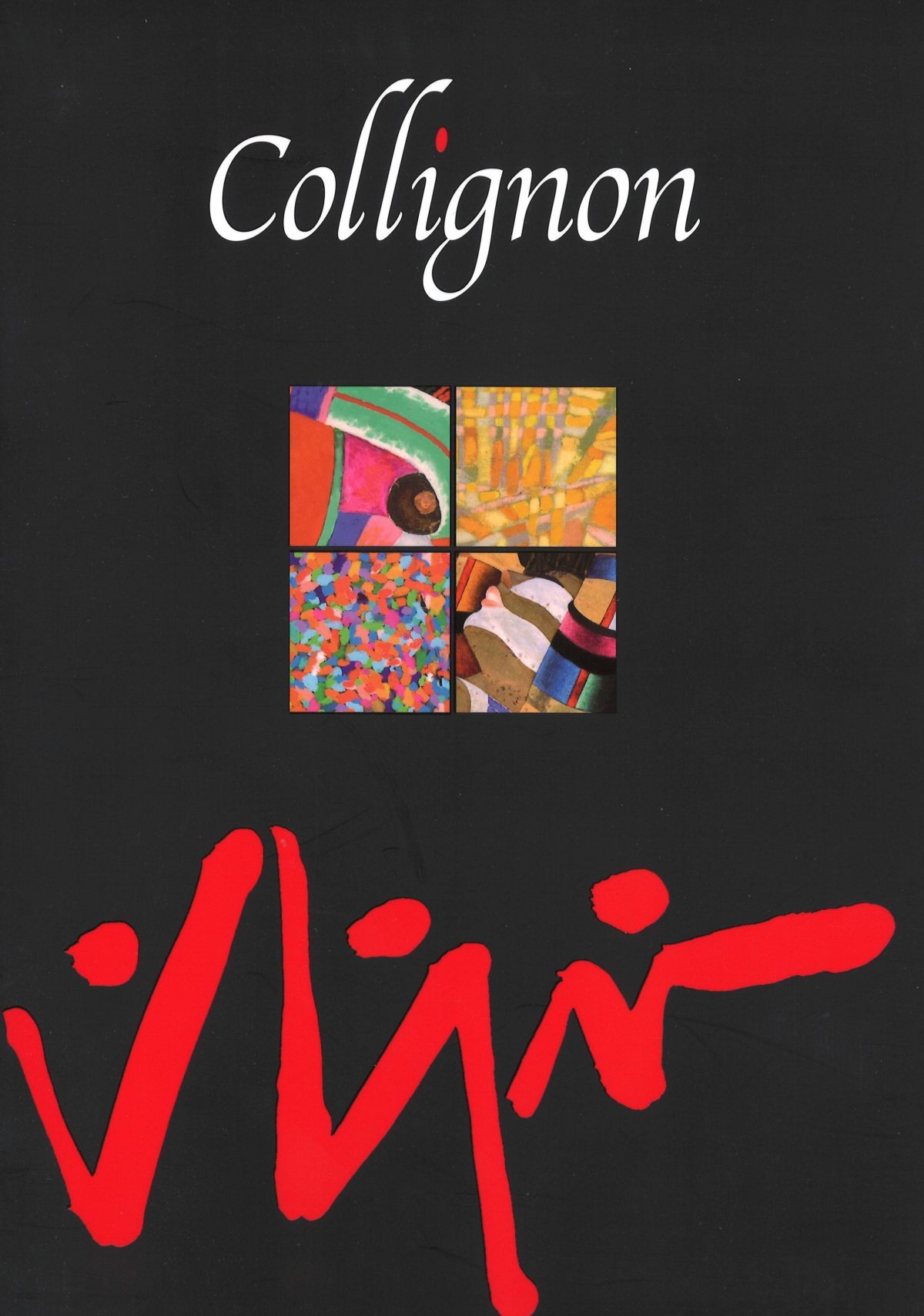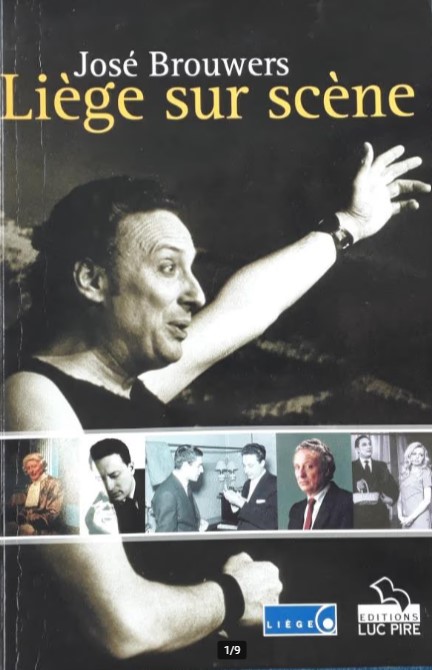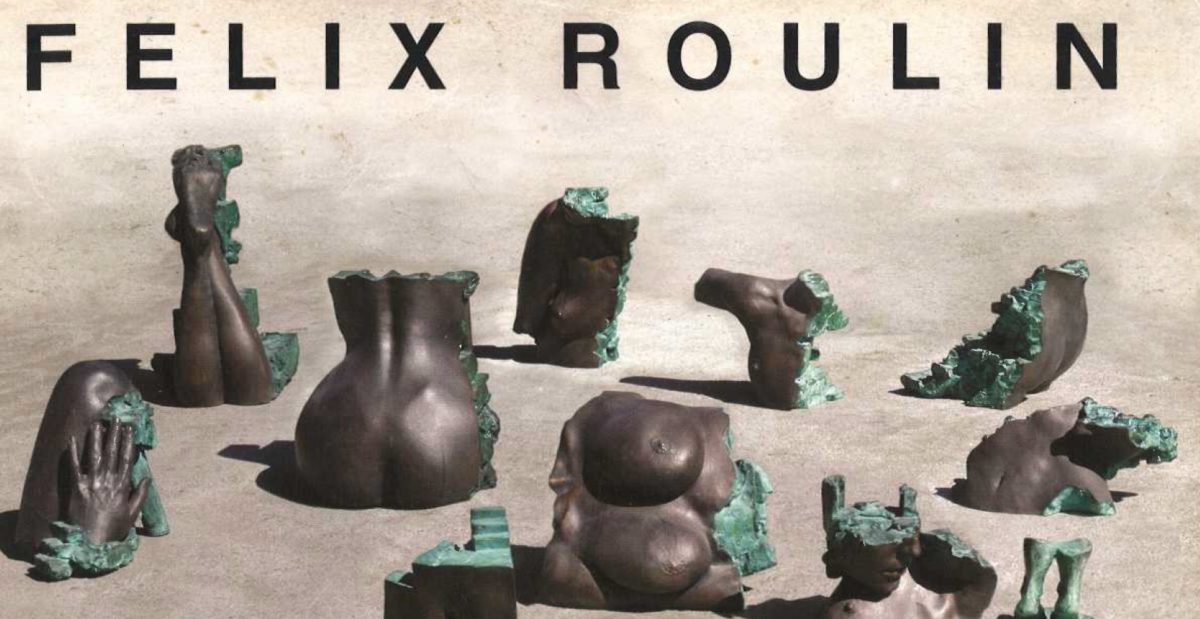Hiver en Ardenne
Noël en Ardenne. Les formes fantomatiques de quelques bouleaux dénudés divisent l’espace. Des épicéas, rassemblés en une masse compacte et sombre, forment écran sur fond de collines. Des cordes de bois attendent le long d’un sentier enneigé. Quelques fermes cherchent frileusement à s’abriter autour d’une église. Un vaste champ étend sur toute sa surface enneigée la fragilité intense d’une blancheur immaculée. Un coupe-feu que le passage des débardeurs a rendu boueux est devenu impraticable : voilà quelques paysages d’hiver observés en leur isolement et transposés par des peintres de l’Ecole Liégeoise du Paysage.
Une exposition thématique est bien le moyen le plus adéquat pour illustrer clairement l’extrême diversité qui, à cause de la liberté d’expression et les subtilités des techniques employées, résulte nécessairement de toute création artistique.
Partant d’une source d’inspiration partagée, chaque artiste improvise, chacun usant à sa guise des moyens conformes à l’intention à réaliser. Comme dans un duel, chaque peintre se réserve jalousement le choix des armes. La plus large diversité est de mise.
De ces multiples variations sur le même thème ne peuvent résulter qu’une hétérogénéité éminemment disparate, ainsi qu’une pluralité surprenante de subjectivités diverses, toutes exprimées de manière plus ou moins exacerbées. Tel peintre se contentera de reproduire, avec une fidélité plus ou moins relative, un coin jugé particulièrement pittoresque. Un autre tentera, à travers la vision d’un refuge forestier, de transposer ses hantises ou ses besoins d’isolement. Pour tel autre encore, le paysage sera prétexte ou support.
Déterminons plus concrètement le sujet, ce paysage à transposer sur la toile. Evitons surtout de confondre les notions, d’amalgamer la fin et la manière, de mêler le résultat recherché aux moyens d’y parvenir. Il s’agit bien de se rendre compte que, même pour un peintre, simplement soucieux de reproduire avec minutie le charme inhérent d’un coin pittoresque (l’orée d’un bois, un étang, une falai-se, une vue panoramique), ce ne sont ni les arbres, ni les collines ou les berges d’un ruisseau qui, à eux seuls, constituent l’essence du paysage. Au-délà de ces éléments mélangés, il s’agit d’un espace à rendre : une étendue géographiquement limitée, un ensemble, hétéroclite certes mais cohérent et harmonieux, animé par les arbres et les collines et traversé, éventuellement, par un cours d’eau. Outre ces composantes-là, cet espace possède sa luminosité propre, son relief, sa profondeur, ses nuances vivifiantes, sa végétation caractéristique, bref une identité que, dans une succession de plans renforcés par les tonalités dominantes, des ombres et des valeurs, l’artiste devra réduire aux deux dimensions de son tableau. En y ajoutant, inévitablement, les acquis de sa propre subjectivité.
Sous le pinceau de Ferdinand Khnopff, maître symboliste renommé séjournant fréquemment à Fosset, au nord d’Amberloup, l’eau étale de l’étang du Ménil n’était nullement une eau morte. A travers la vision familière du domaine familial, le peintre rend perceptible le frimas matinal, projettant ainsi dans une oeuvre aux apparences réalistes, cette mélancolie accablante qui, renaissant sans cesse d’une égocentrique lassitude, ne le quitte jamais.
A l’opposé de celui-ci, Lucien Hock, dans ses paysages fagnards, transposa douloureusement la vacui-té des hauts plateaux qui bordent les tourbières. Il accentua à plaisir la noirceur des sapins, visiblement plus sombres qu’ailleurs, pour qu’ils forment écran et lui permettent ainsi de parachever une insolite et manifeste théâtralité.
Plus distant, comme s’il se contentait de rechercher uniquement l’objectivité du lieu, Paul Lepage peint le chemin creux que le charroi a défoncé. Au-delà d’un semblant de froideur, il exprime, presque malgré lui, une douce sentimentalité, qui, si elle demeure à fleur de peau, n’en est pas moins désarmante et bénéfique.
Originaire de Flandre, Evariste Carpentier se souviendra des leçons d’Heymans et Claus. Il côtoya longuement les impressionistes français, dont Monet, qui engendrèrent, chez lui, une nouvelle vision. Traitant le paysage dans une optique délibérément impressionniste, il sera, indéniablement, le pré-curseur belge de ce mouvement. Prônant les théories luministes et incitant ses élèves à se préoccuper davantage des phénomènes visuels et des problèmes de luminosité, il débarrasse, définitivement croit-il, la peinture liégeoise de la grisaille et des contours.
Ainsi, face au paysage choisi, tous établissent avec celui-ci des liens différents. Ne fut-ce que pour certains, tel Richard Heintz, dans le but avoué d’aller à l’extrême et de se dépasser toujours davantage. Bien avant que ne fut pratiqué véritablement [et presque exclusivement) cet art du paysage, né avec l’impressionnisme, les règles principales qui allaient le régir préexistaient déjà. Bruegel, en son temps, pressentait les possibilités multiples de l’environnement familier, visualisé en ses variations saison-nières bien connues. Sachant que ces moyens étaient susceptibles de participer à son art basé sur la narration et la communication, il avait, dans son célèbre tableau Le dénombrement de Bethléem, créé admirablement une singulière vision d’ensemble. Ayant transposé la Judée biblique en terre brabançonne, il avait magistralement concrétisé une étonnante impression de ferveur en marche sur fond de blancheur hivernale. Au-delà de cette transposition, il avait cherché à convaincre ses contempo-rains que la transhumance humaine provoquée par les vicissitudes juridiques d’un dénombrement imposé par une autorité étrangère, devait être considérée comme un bain de jouvence, prélude à une renaissance due à une ère nouvelle.
La présente exposition fut réalisée par la juxtaposition nécessairement arbitraire de deux notions aisément rapprochées : Noël [hiver, froidure, isolement) et Ardenne [la définition géographique englobant dans ce cas, outre la région située au sud de Liège, les solitudes fagnardes à l’est de cette ville).
Jacques Goijen, collectionneur, découvreur, organisateur infatigable d’expositions concernant la peinture dite de l’École Liégeoise du Paysage, n’en est certes pas à son premier essai en ce domaine. Usant des multiples possibilités que les expositions thématiques mettent à sa libre disposition, il rassemble judicieusement quantité d’oeuvres éminemment dissemblables et que seul un fil conducteur, fut-ce un lien ténu, relie entre elles. Procédant de la sorte, provoquant des voisinages insolites et des rencontres plus ou moins fortuites, il aiguise la curiosité, voire la complicité active du spectateur. Par ce truchement, il force ce dernier à prêter davantage attention aux différenciations, aux subtilités du langage pictural, aux techniques, aux nuances, aux différences d’interprétation ou de transposition, bref au style sinon à l’unicité des compositions mises en exergue.
Ce moyen lui permet surtout de faire partager avec d’autres amis, les joies enthousiasmantes, bien réelles et pourtant peu définissables, de la découverte. Un simple aveu de ma part explicitera peut-être plus concrètement ce propos que ne le feraient une argumentation spécieuse ou une dialectique rigoureuse : chaque nouvelle exposition mise en place par Jacques Goijen, m’a permis de découvrir des auteurs inconnus, des valeurs insoupçonnées. Toutes m’ont permis, au-delà du plaisir esthétique ressenti, de rendre justice à quelque peintre dont l’oeuvre fut, après sa mort, bien injustement mise sous le boisseau.
Dans ce contexte précis, je n’hésite pas à citer volontiers les noms de Ludovic Baues, Joseph Bonvoisin, Emmanuel Meuris, Robert Nibes, Louis Thérer ou Fernand Vetcour, me contentant d’énumérer ces quelques noms sans vouloir établir une quelconque gradation dans les talents ou les valeurs. Prétendre que cette liste n’est en rien limitative, relèverait seulement du pléonasme ! Il va également de soi que je ne concède nullement aux seules expositions précitées, l’admiration due aux oeuvres de Heintz, Jamar, Donnay, Mambour, Pasque ou Scauflaire, même s’il est hautement réjouissant de retrouver, de temps à autre, en si heureuse compagnie, des compositions plus ou moins inédites de ces maîtres, dont plus personne n’ignore encore l’importance.
Noël en Ardenne. Des tourbières fagnardes entourent de leurs solitudes une croix esseulée, indiquant ainsi l’endroit précis où disparurent des fiancés légendaires. Neiges en hiver sur fond de collines estompées par les bancs de brouillard qui traînent. Paysages captés en leur âpreté par des peintres désireux de transposer ainsi le reflet de leur propre désarroi. Entre l’arbre sans feuilles et l’autre rive de l’étang nocturne, les glaces de l’embâcle se disloquent. Une lumière étrangement diffuse accentue le côté tragique d’une vision hivernale. La saison d’hiver a de ces démesures.
Dans un livre auquel j’avais collaboré avec lui, Omer Marchal avait écrit : “Mon Ardenne à mot, l’Ardenne d’un Ardennais ordinaire : un petit pays immense où tout se passe en une vie. Dire l’Ardenne, c’est dire forêt. Un terroir noir, sans aménité.”
Il y a quelques jours, comme sur la pointe des pieds, Omer Marchal nous a quitté pour s’en aller au pays de son père où, d’après Verlaine, les bois sont sans nombre … Qu’il nous soit permis d’évoquer une franche amitié et de dédier ce texte à sa mémoire ardennaise.
Jo Verbruggen (10 novembre 1996)
Pour en voir plus…
Les artistes présentés
-
-
- ABSIL Félicien
- BONVOISIN Joseph
- CAMBRESIER Jean
- DELFOSSE Joseph
- DELSAUX Jérémie
- FABRY Lucy
- FAISANT Luc
- FAUFRA Roger
- FRANCOIS Jean
- HANSOTTE Gaston
- HEINTZ Richard
- HUQUE Ivan
- IGOT Andrée
- JACOBS Dieudonné
- JAMAR Armand
- LIARD Robert
- MARTINET Milo
- NIBES Robert
- PASQUASY Emile
- PRINCE Ferdinand
- THEATRE Henri
- THERER Louis
- THEUNISSEN Paule
- VETCOUR Fernand