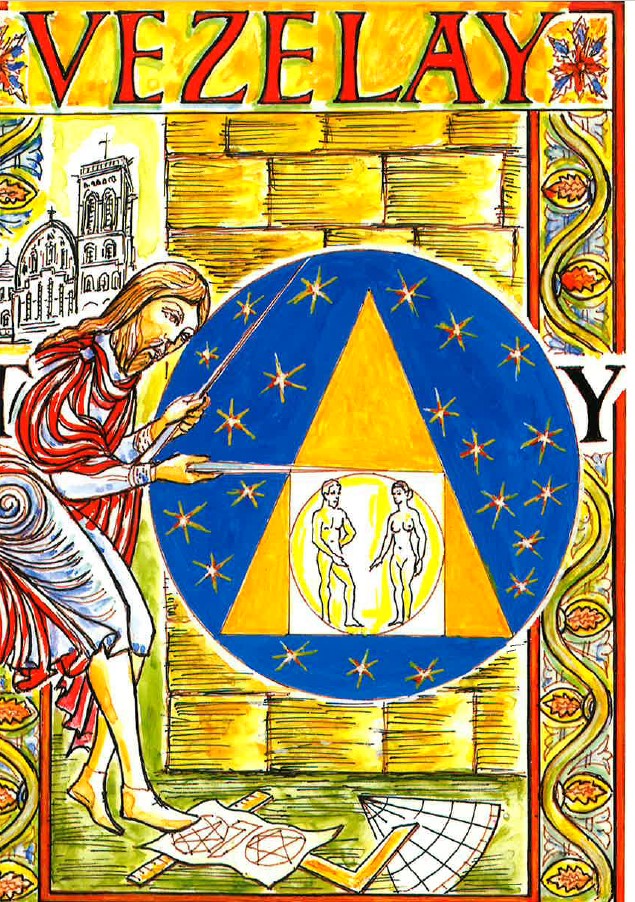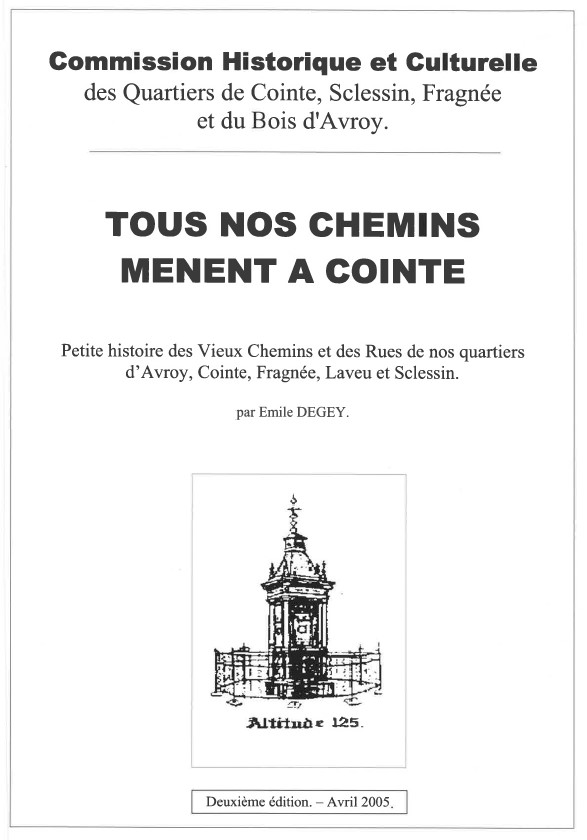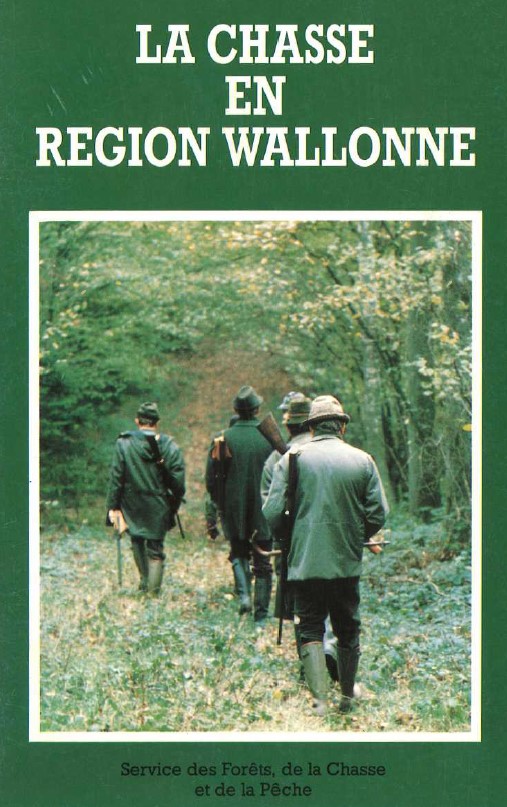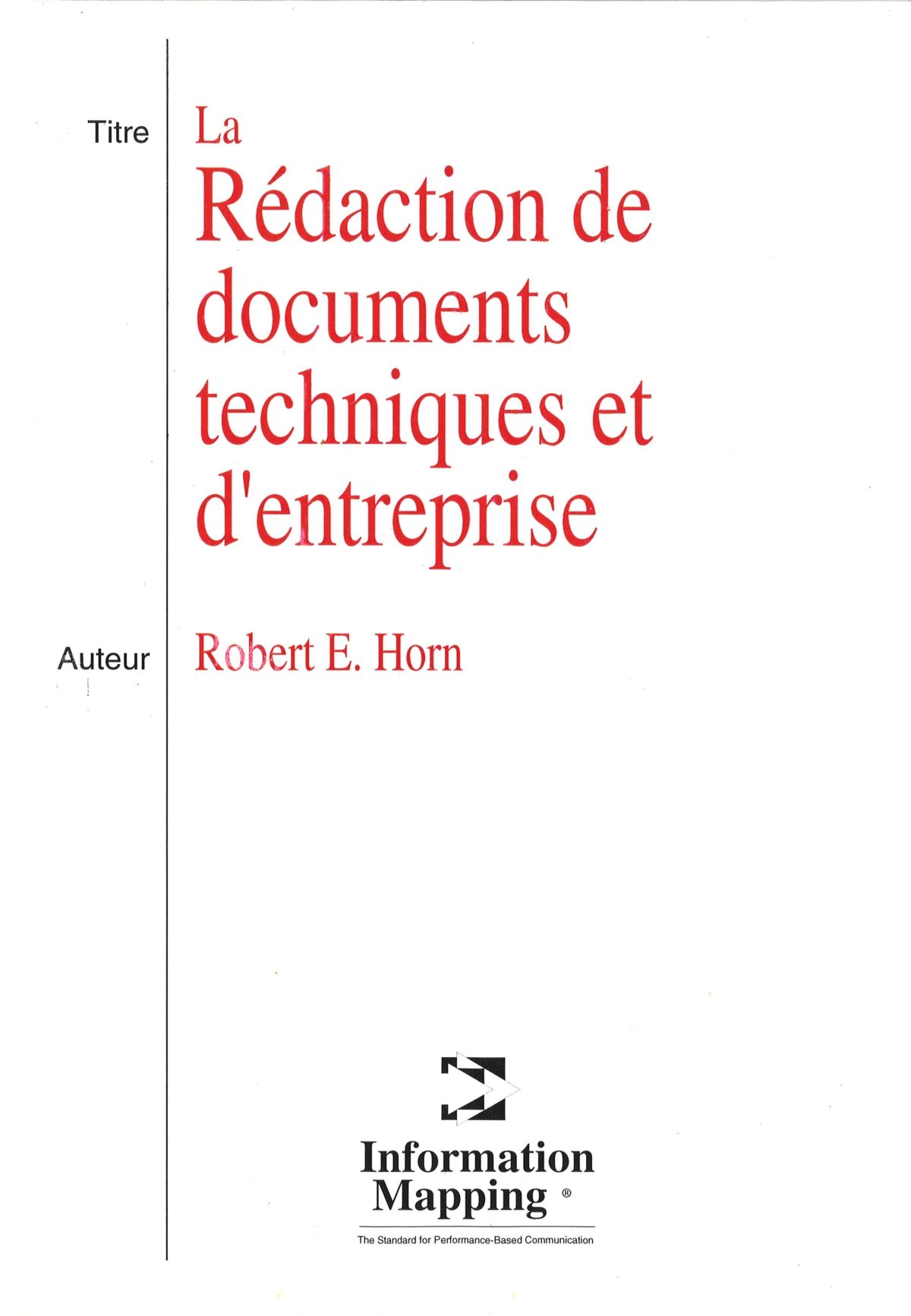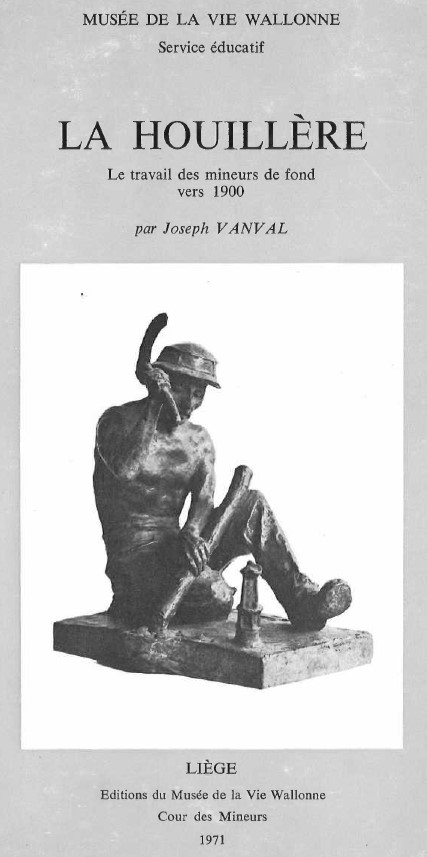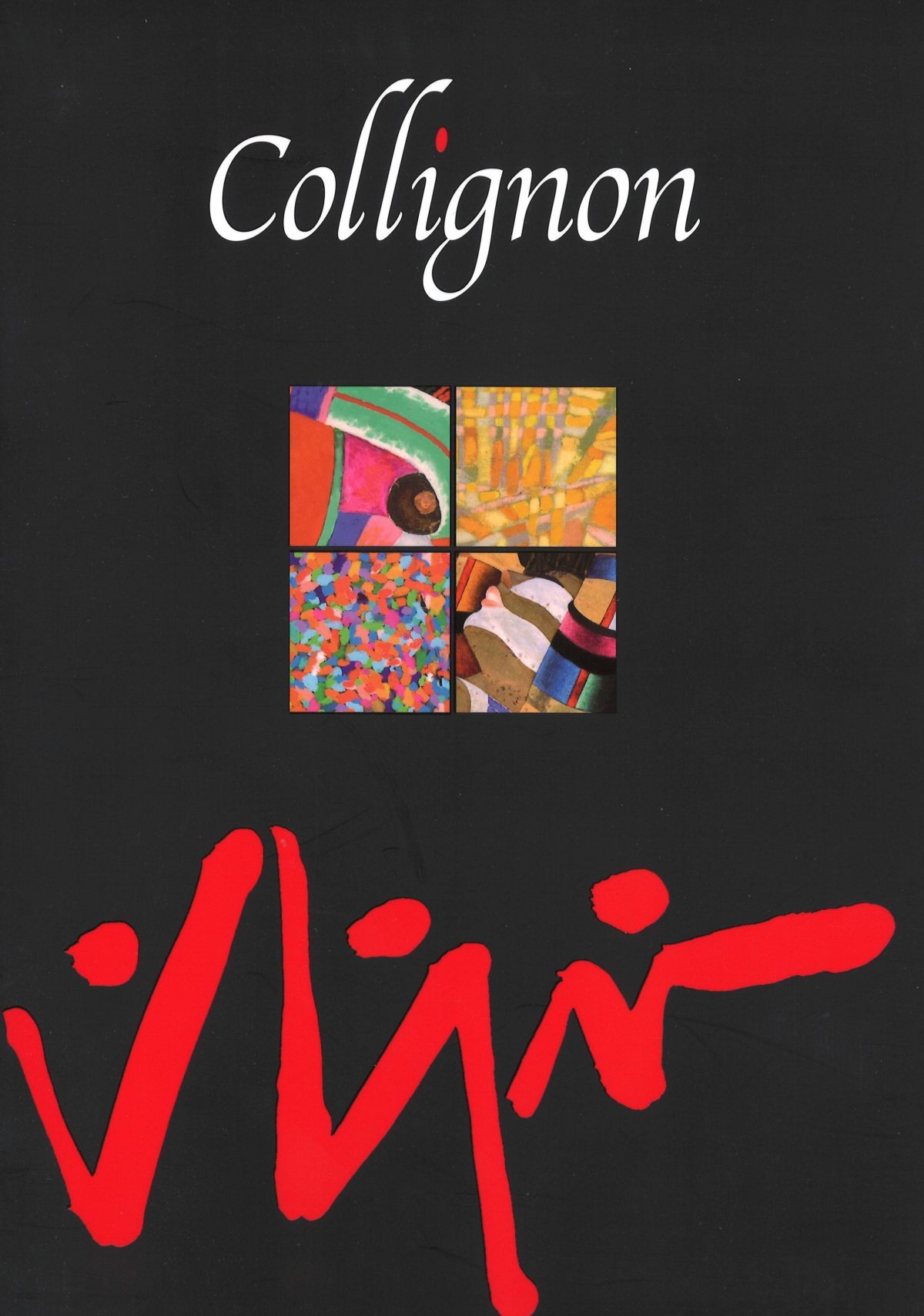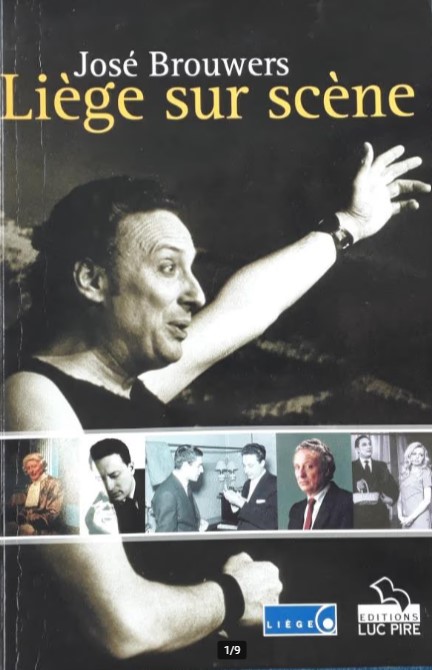[CONNAITRELAWALLONIE.WALLONIE.BE] 1er juin 1938. Fernand Dehousse et Georges Truffaut publient L’État fédéral en Belgique. Depuis 1930, la Concentration wallonne tente de fédérer l’ensemble des groupements wallons autour d’un projet fédéraliste wallon commun. Sans succès. La Ligue d’Action wallonne décide de mener seule la rédaction d’un projet de statut fédéral. Rédigé par Fernand Dehousse et Georges Truffaut, L’État fédéral en Belgique s’accompagne d’un projet de Constitution fédérale. Le texte prévoit un système composé de trois régions, Flandre, Wallonie et Bruxelles, dont la frontière linguistique forme la limite entre les deux régions ; dans les communes situées sur la frontière, un référendum sera organisé si au moins 30% des électeurs communaux en font la demande. Tout en supprimant les provinces, le projet présente la particularité d’attribuer aux régions tous les pouvoirs que la Constitution n’attribue pas expressément au pouvoir central. Le 1er juin 1938, Georges Truffaut, François Van Belle et Joseph Martel déposent le texte sous forme de proposition de révision de la Constitution à la Chambre.
Institut Jules-Destrée

L’État fédéral en Belgique de Fernand Dehousse et Georges Truffaut
Publié en 1938, ce texte de révision de la Constitution n’émane pas d’un parti politique mais du Mouvement wallon, et plus exactement de la Ligue d’Action wallonne, très active à Liège depuis plusieurs années. En effet, les militants de cette Ligue pluraliste s’interrogeaient sur le devenir politique de la Wallonie au sein de l’Etat belge. Un Etat unitaire dans lequel, par le fait de la démographie et du suffrage universel, les Wallons deviennent de plus en plus une minorité politique, avec les incidences que cette situation engendre dans un système unitaire et centralisé.
Dès les années 1920, la Ligue d’Action wallonne s’est préoccupée d’une solution politique à apporter aux relations difficiles entre Wallons et Flamands aux intérêts divergents. Néanmoins, les positions des militants wallons quant à la forme à donner à cette solution ont mis du temps à s’harmoniser. Un premier pas a été franchi en 1931, lors d’un Congrès de Concentration wallonne : les principes d’une Constitution fédérale basés sur deux régions et un territoire fédéral sont acquis à la quasi-unanimité des quelque 200 participants, représentant 37 ligues et groupes wallons. Mais les années suivantes ne voient pas la concrétisation du projet alors que la situation économique wallonne va en se dégradant ; de plus, le vote par les Chambres de l’adaptation du nombre de sièges parlementaires aux chiffres de la population maintient sinon renforce la minorisation politique de la Wallonie.
Devant le constat de carence des Congrès successifs de Concentration wallonne, la Ligue d’Action wallonne reprend l’initiative. Au cours de l’année 1937, une commission interne s’attèle à la tâche. Le 15 mars 1938, l’achèvement d’un projet de statut fédéral est annoncé dans L’Action Wallonne, le journal de la Ligue. Avant d’être déposé à la Chambre, le projet fait l’objet d’une publication en brochure – le présent fac-similé – en tous points identique à la proposition de révision de la Constitution, déposée à la Chambre.
Proposition de révision de la Constitution : tel est l’intitulé officiel du texte déposé à la Chambre des Représentants en sa séance du 1er juin 1938. Les signataires de ce Document parlementaire sont trois députés socialistes wallons, Georges Truffaut, François Van Belle et Joseph Martel, soit respectivement deux élus de l’arrondissement de Liège et un élu de l’arrondissement de Soignies. En juillet, présenté au deuxième congrès des socialistes wallons, le texte est… encommissionné.
Précédant le Projet de Constitution fédérale proprement dit, un long exposé des motifs ne comptait pas moins de sept paragraphes parmi lesquels les éléments justifiant la démarche compte tenu des rapports Flamands-Wallons dans différents domaines ; les diverses solutions envisageables allant de la déconcentration du fédéralisme ; les choix possibles à l’intérieur même du terme générique de fédéralisme ; la formule d’association privilégiée par la Ligue d’Action Wallonne, soit la Région comme base de l’État fédéral ; les institutions politiques de celle-ci et leurs attributions ; les instances politiques fédérales et leurs compétences. Selon les rédacteurs, l’État fédéral préconisé denit reposer sur trois Régions : Wallonie, Flandre, Bruxelles. Pour la première fois, la Wallonie se voit dotée de la direction de ses affaires propres dans des matières importantes et protégée par des mesures de sauvegarde en d’autres domaines.
A un double titre, cette proposition d’État fédéral est une première du côté wallon : d’une part, elle fournit une étude fouillée sur la situation ainsi que la solution à y apporter; d’autre part, elle prolonge la démarche sur le terrain législatif. Toutefois, la prise en considération de cette proposition est rejetée par la Chambre, le 2 février 1939, par 111 voix contre 62 et 4 abstentions.
La publication des Écrits politiques wallons de Georges Truffaut, en attendant ceux de Fernand Dehousse, est l’occasion, pour l’Institut Jules-Destrée, de rééditer cette archive historique. À près de soixante-cinq ans de distance, ce projet de statut fédéral, mis à part quelques rides, a plus d’une parenté avec
la situation actuelle. Il témoigne encore aujourd’hui de l’engagement, contre vents et marées, de militants wallons pour l’affirmation et la reconnaissance politiques de la Wallonie.
Micheline Libon, historienne, Institut Jules-Destrée
Au sein de la Ligue d’Action wallonne, Georges Truffaut (1901-1942) et Fernand Dehousse (1906-1976) ont été les principales chevilles ouvrières dans l’élaboration du projet fédéral.
Georges Truffaut (1901-1942), officier de la marine marchande et journaliste, était un militant wallon depuis les années passées à l’Athénée de Liège. Conseiller communal dès 1932 puis échevin de la Cité ardente en 1935, il siégeait à la Chambre depuis 1934. Passionnément engagé tant dans le développement de sa ville que pour la Wallonie, il n’eut de cesse de faire reconnaître une autonomie politique à celle-ci, tout en envisageant des liens plus étroits avec la France. Ses articles dans La Wallonie et dans les journaux du Mouvement wallon – La Barricade et L’Action wallonne – ainsi que ses interventions à la Chambre en témoignent à suffisance. À la fin de sa vie, il se disait fermement attaché à une Belgique fédérale, partie prenante d’une Fédération européenne au sein de laquelle l’originalité wallonne serait sauvegardée et l’épanouissement culturel, économique et social de la Wallonie assuré. Farouche opposant à la politique d’indépendance, il refusa la capitulation du 28 mai 1940 et rejoignit l’Angleterre où il trouva la mort lors d’un exercice militaire.
Liégeois lui aussi, Fernand Dehousse (1906-1976), docteur en droit et licencié en sciences sociales, enseigna le Droit des gens à l’Université de Liège et à l’École supérieure des Sciences commerciales et économiques. Militant wallon au sein de la Ligue d’Action wallonne surtout à partir de 1936, il tenait la chronique Propos de doctrine (1937-1940) dans le mensuel L’Action wallonne. Il y traitait, entre autres, de la réforme de structure de l’État et des problèmes internationaux. C’est lui surtout qui donna à la Ligue d’Action wallonne les références doctrinales et la formulation juridique nécessaires aux revendications de réforme de l’État. En 1942, Fernand Dehousse adhéra au groupe clandestin Rassemblement démocratique et socialiste wallon, fondé cette année-là. Ce groupe rassemblait des libéraux, des socialistes et des militants wallons sans appartenance politique. À l’époque, Fernand Dehousse se situait dans l’aile gauche du parti libéral. L’année suivante, il rejoignait la fédération liégeoise du PSB et s’attelait à un Projet d’instauration du fédéralisme en Belgique, publié en 1945. Dès lors, au sein des socialistes wallons, il s’imposa comme le porte-parole du fédéralisme.
Sénateur socialiste (1950-1971), deux fois ministre (juillet 1965-février 1966 ; février 1971-novembre 1972), Fernand Dehousse prit une part active aux diverses étapes de la révision de la Constitution. Il fut aussi un acteur agissant dans les différentes institutions européennes qui se mirent progressivement en place au lendemain de la Libération. Fédéraliste wallon, Fernand Dehousse était en même temps fédéraliste européen. Il n’y avait, selon lui, nulle incompatibilité entre un fédéralisme interne et un fédéralisme externe.
Pour en savoir plus…